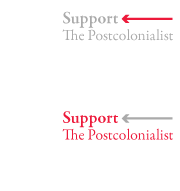Abstract
Cet article a pour but de souligner le dilemme linguistique auquel sont confrontés les écrivains francophones et anglophones africains pour préserver et transmettre leur culture. En effet, alors que la plupart des Africains s’expriment couramment dans leurs langues maternelles, ils n’écrivent que dans les langues héritées de la colonisation. Dans cette analyse, nous proposons la traduction entre langues africaines et européennes comme résolution possible du dilemme linguistique des écrivains postcoloniaux africains.
……..
The purpose of this article is to show the different positions of the major writers of Black Africa on the use of colonial languages in African literature. While most of them are for the use of Western languages in the transfer of African cultural heritage, others encourage new generations of Africans to write in their local languages. Translation between African and European languages appears as an alternative to remedy this linguistic dilemma.
Introduction
Depuis les premiers contacts entre les Européens et les Africains, l’écriture est devenue un outil de communication indispensable pour le continent africain. En effet, non seulement elle a rendu l’Afrique plus visible au reste du monde, elle a aussi permis aux populations lettrées, en particulier les élites intellectuelles, d’avoir accès aux cultures occidentales. Cependant, dès le début du XXe siècle, avec l’avènement des écrivains Thomas Mofolo, Léopold Sédar Senghor et Chinua Achebe, il nous semble que l’écrivain noir, qui prend la plume pour décrire son monde et transmettre son héritage culturel, est confronté à un dilemme qui s’est progressivement mué en un malaise récurrent. En effet, un certain nombre de questions se posent dès qu’on évoque la relation entre l’écrivain noir et la langue qu’il a adoptée et dont il se sert pour être le porte-parole de son peuple ou, comme l’écrit Aimé Césaire, pour être « la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche, ma [la] voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir » (Césaire, 1983 : 22). D’une part, nous pouvons nous demander si les écrivains africains ne renoncent pas à une partie d’eux-mêmes lorsqu’ils écrivent en français, en anglais ou dans toute autre langue occidentale, c’est-à-dire dans la langue du colonisateur ; d’autre part, en s’appropriant ces langues afin de véhiculer leur culture, ne peut-on pas considérer qu’ils en font des instruments ou des armes contre l’aliénation et l’hybridité culturelles dans lesquelles la progressive désuétude de la tradition orale tend à plonger ces mêmes cultures?
Dans cet article, nous mettrons en relief les diverses positions des écrivains majeurs de l’Afrique noire sur l’usage des langues européennes dans la littérature africaine. La problématique est la suivante : comment concilier la position des passeurs de culture, qui, comme Senghor, pensent qu’il est nécessaire que les Africains fassent du français un outil d’expression, et la position de Julius Nyerere et de Ngugi Wa Thiongo’o, qui estiment que les écrivains devraient plutôt écrire en langues africaines telles que le kiswahili ? Enfin de compte, notre analyse nous permettra de suggérer des solutions (notamment la traduction ou l’apprentissage des langues africaines) d’interaction entre langues africaines et langues européennes afin de transformer la dépendance actuelle des écrivains noirs envers les langues européennes en une interdépendance des écritures africaines et occidentales.
I. Du griot à l’écrivain : quelques repères sur le transfert de l’héritage culturel africain
L’héritage culturel d’un peuple, d’une nation ou d’un continent est ce qui est transmis consciemment ou inconsciemment de génération en génération. Pour des raisons évidentes, comme la défaillance de la mémoire collective, l’illisibilité, l’incompréhension ou la vétusté d’un appareil de transmission, la perte d’un outil de transmission, la volonté d’occulter un aspect déplaisant de culture etc., le transfert de l’héritage culturel ne peut prendre en compte la globalité des éléments constitutifs de la culture ; il ne porte que sur des aspects importants défendus par chaque peuple. Pour la plupart des sociétés, l’héritage culturel est véhiculé par la langue, l’écriture et la parole, des entités dont le fonctionnement et la prédominance ne s’inscrivent pas forcément dans un rapport chronologique, d’évolution ou d’exclusion. En ce qui concerne l’Afrique, la parole est sans doute le principal transmetteur des savoirs ancestraux. Comme l’écrit Jacques Chevrier dans L’Arbre à palabres, s’il convient de souligner qu’il n’est plus question, aujourd’hui, d’étudier les sociétés traditionnelles africaines sous l’angle réducteur de sociétés sans écriture, la parole demeure, malgré les évolutions constatées depuis le début du vingtième siècle, « le support culturel prioritaire et majoritaire par excellence, dans la mesure où elle en exprime le patrimoine traditionnel et où elle tisse entre les générations passées et présentes ce lien de continuité et de solidarité sans lequel il n’existe ni histoire ni civilisation » (Chevrier, 2005 : 9). La parole est le fait de l’individu ordinaire mais selon l’aire géographique où l’on se situe sur le continent africain, il est généralement admis qu’elle a pour dépositaire, comme le note Chevrier, « une gamme étendue de spécialistes, bardes, musiciens, chanteurs, généalogistes, historiens, conteurs, griots, joueurs de mvet…qui ont chacun un rôle bien précis dans la société à laquelle ils appartiennent et dont les fonctions peuvent évoluer de manière extrêmement subtile d’un groupe à l’autre » (Chevrier, 2005 : 23)
De tous ces spécialistes, le rôle du griot est le plus connu. Malgré le célèbre mot d’Amadou Hampâté Bâ, qui compare dès 1960 la disparition d’un vieillard en Afrique à une bibliothèque qui brule, l’importance du griot surpasse celui du vieillard. S’il est vrai que les aînés sont perçus comme les transmetteurs de la sagesse ancestrale, il faut reconnaître que toutes les personnes âgées n’ont pas forcément la qualité d’hommes sages. À l’opposé, tout griot revêt un statut particulier puisqu’il est à la fois historien, conteur, musicien et philosophe. Si l’origine du terme « griot » reste à élucider, Thomas Hale pense que sa fonction semble avoir été portée à la connaissance du monde occidental grâce au roman Roots (1976) d’Alex Haley. Le téléfilm qui en est issu a permis de faire connaître cette quête identitaire à un plus grand nombre d’Américains et au monde entier. Dans la seconde partie du téléfilm réalisé à partir de ce roman historique qui prône le retour aux sources des Africains-Américains, Kunta Kinte (dont le rôle est joué par l’acteur James Earl Jones) rencontre un griot gambien. Dans son désir de rendre le rapprochement entre l’Amérique noire et l’Afrique réaliste, le réalisateur fait jouer ce rôle, non pas à un acteur professionnel, mais à un vrai griot, du nom d’Alhaji Bai Konte (Haley, 1976 : 72).
Pour les Occidentaux, cette rencontre, centrale dans le roman et dans le film, est forcément exotique, car elle les fait sortir de leur monde sophistiqué pour les transporter dans une Afrique dont le lien entre le passé et le présent reste visible. Par contre, pour la population ouest-africaine et les africanistes en général, le griot rappelle les liens séculaires qui partent de l’Afrique antique à celle d’aujourd’hui. Les attributs du griot sont donc largement connus, malgré l’impact de la colonisation sur les jeunes générations. Dans son rôle de courroie de transmission de la culture d’une génération à l’autre, il représente la mémoire vivante de la société africaine. Le fait que son savoir ne soit pas livresque soulève des questions sur la véracité de ses propos ou sur la relation entre les versions actuelles de l’histoire, des mythes et épopées qu’il transmet et celles d’autrefois. Y a-t-il pertes ou rajouts dans la transmission orale des us et coutumes ? L’art du griot ne relève-t-il pas davantage d’une imagination créatrice que d’une transmission fidèle et infaillible de la réalité historique ?
Ces questions, bien sûr, ont leur place aussi dans la société moderne caractérisée par un rationalisme exacerbé et une scientificité à toute épreuve. Il est cependant utile de savoir que le griot reçoit une formation rigoureuse dans la plupart des sociétés traditionnelles africaines. Dans l’empire mandingue, qui correspond de façon approximative à l’Afrique occidentale d’aujourd’hui, le griotisme, la science et la rhétorique du griot, n’est pas un art populaire ou démocratique, car il se transmet exclusivement au sein de la caste des griots dans laquelle les familles se spécialisaient dans la généalogie, l’histoire de la communauté, l’art oratoire ou la pratique musicale. Le griot apprend son métier auprès d’un autre griot issu de sa famille. Par la suite, il se doit d’approfondir ses connaissances en effectuant des séjours de formation auprès d’autres griots de la région et en visitant les lieux de mémoires évoqués dans les épopées et les mythes qu’il est chargé de transmettre à la génération à laquelle il appartient.
De nos jours, on continue de penser, à juste titre, que la colonisation occidentale et l’européanisation de la société africaine ont écorché la pureté et l’authenticité de la culture africaine dans la mesure où certains référents culturels ont perdu de leur importance dans la société moderne à cause de l’imposition de la langue du colonisateur et de la circulation de l’information dans cette même langue. Cependant, on oublie souvent de mentionner que l’oralité, malgré qu’elle soit dominante en Afrique noire, a coexisté avec certaines formes d’écriture. Dès lors, on se demande pourquoi cette culture, jadis essentiellement axée sur l’oralité, se transmet de plus en plus par l’intermédiaire de l’écriture et, en particulier, de l’écriture en langues européennes. Très peu de personnes seraient surprises d’apprendre que l’écrivain noir africain occupe à peu près, depuis le début du vingtième siècle, la place qui était auparavant dévolue au griot. Ce dernier, quand il existe encore dans les sociétés africaines, continue de jouir d’une renommée appréciable. Cependant, force est de reconnaître que son rôle est de plus en plus réduit à celui de bouffon, d’amuseur public ou de troubadour dans les meilleurs des cas, ce qui n’était qu’une infime partie de sa mission dans l’Afrique ancienne.
Depuis le début de la présence européenne en Afrique, la tendance est d’inscrire l’histoire et la culture africaines dans le temps en lui donnant une forme scripturale. Le critique ayant le mieux compris ce phénomène est sans doute Frantz Fanon, lorsqu’il évoque le rapport du colonisé avec les langues européennes. Son argumentation, amplement développée dans Peau noire, masques blancs, au sujet de la psychologie de l’Antillais semble aussi valable pour les peuples des anciennes colonies africaines. En effet, selon Fanon, pendant et après la colonisation, le colonisé affiche un complexe d’infériorité qui est perceptible à plusieurs niveaux de sa vie sociale. L’un des signes de ce complexe est son attitude face à la langue du colonisateur, dont la maîtrise l’élève au-dessus de son semblable et le fait jouir d’une certaine honorabilité (Fanon, 1952 : 14)
Quant à Albert Memmi, il met l’accent sur les conséquences de l’adoption de la langue du colonisateur. Dans Portait du colonisé, il affirme que cet état de fait provoque une « amnésie culturelle » (Memmi, 1985 : 120). On ne peut pas oublier de souligner que l’un des objectifs de l’oppression impériale était le contrôle de la langue de communication du colonisé. Tout l’enseignement mis à sa disposition, ainsi que les méthodes utilisées, les ouvrages, les modes de pensées véhiculés, etc., n’avaient pour but que de remplacer la langue du colonisé par celle du colonisateur. Cependant, cela suffit-il à provoquer l’amnésie culturelle, comme le pense Memmi ? Ce dernier ne reconnaît-il pas, sans se réjouir pour autant, que, dans le contexte colonial, le bilinguisme était nécessaire et qu’il était la « condition de toute communication, de toute culture et de tout progrès » (Memmi, 1985 : 124) ? C’est sans doute pour éviter cette amnésie culturelle que la plupart des écrivains africains issus des colonies françaises ou anglaises, ont opté pour la langue du colonisateur dans l’écriture de leurs romans, poèmes ou pièces de théâtre. Comment vivent-ils cette non-coïncidence de leur langue maternelle avec leur langue d’écriture, devenue instrument de transfert de leur culture ? Pourquoi, comme l’écrit Memmi, leur participation conflictuelle à « deux royaumes psychiques et culturels » (Memmi, ibid.) du colonisateur et du colonisé, ne les contraint-elle pas à renoncer à la langue du colonisateur ?
II. Littérature et transfert culturel : le dilemme linguistique des écrivains africains
Est-il besoin de rappeler, ainsi que l’écrit Lewis Nkosi au sujet de la crise linguistique en Afrique subsaharienne, que la littérature d’expression anglaise ou française, cette littérature dite postcoloniale, est née dans le contexte de la contestation coloniale et qu’elle en porte donc les stigmates (Nkosi, 1981 : 1) ? Écrire en français ou en anglais semble s’imposer aux premiers écrivains africains, ces hommes de lettres qui se sont arrogé le statut de passeurs de culture au détriment du griot ou du vieillard, dont les rôles étaient en porte-à-faux dans les infrastructures coloniales. La question de savoir s’ils étaient confrontés à un dilemme (écrire dans la langue du colonisateur ou dans leurs langues maternelles) a été souvent posée, car la plupart des grands écrivains africains jouissant d’une renommée internationale ont écrit soit en français, soit en anglais. Il est donc important de faire le panorama des choix linguistiques des écrivains africains, tout en l’actualisant, afin de comprendre les prises de positions de certains écrivains avant-gardistes aussi bien dans les anciennes colonies anglaises que françaises.
a) De Thomas Mofolo à Ngugi Wa Thiong’o : les pionniers de l’écriture en langues africaines dans le monde africain anglophone
C’est à tort qu’on se réfère aux écrivains de la Négritude comme les premiers écrivains d’Afrique subsaharienne. En effet, si leur avènement a été un fait marquant dans l’histoire des littératures d’Afrique noire, il faut noter que les écrivains de l’Afrique australe ont été les premiers à écrire des œuvres littéraires. Il est utile de rappeler brièvement leurs positions et leurs choix linguistiques car, contrairement à ce qu’on pourrait penser, ils n’ont pas tous adopté la même attitude face à l’utilisation des langues occidentales. Le premier d’entre eux, Thomas Mofolo (1876- 1948), qui n’usurperait pas le statut de père de la littérature africaine, est un écrivain du Lesotho qui a écrit tous ses romans en sésotho, sa langue maternelle. Il a notamment écrit Moeti oa bochabela (1907), Pitseng (1910) et Chaka (1910).
Le parcours littéraire de cet écrivain mérite l’attention de ceux qui s’intéressent à l’émergence de la littérature africaine. Habitués à envisager cette littérature soit en la divisant en littérature d’expression anglophone et littérature d’expression francophone, soit (moins fréquemment) entre les productions en langues africaines et les productions en langues européennes, les africanistes ont souvent oublié de souligner le fait qu’au début du XXe siècle, c’est le passage de l’oral à l’écrit, ou du texte recueilli au texte original qui constituait la principale rupture. Malgré des contacts étroits avec les Européens et une bonne connaissance de l’anglais, Mofolo a choisi d’écrire ses textes dans une langue que personne avant lui n’avait utilisée pour écrire ou même transcrire un texte en prose.
Le roman Moeti oa bochabela est une œuvre d’imagination qui se distingue par son originalité aussi bien du fond que de la forme. L’histoire se déroule en Afrique du Sud à une période où ce pays n’était pas encore en contact avec les Européens. Son personnage principal, Fekisi, un homme épris d’amour, de tranquillité et de justice, finit par se convertir au christianisme. En tenant compte du contexte de publication du roman (à savoir la propagande du Christianisme ayant suivi les premiers contacts entre Africains et Européens), on peut affirmer qu’il prône l’abandon des valeurs culturelles africaines et fait l’apologie du christianisme, perçu par le narrateur comme une religion permettant à l’être humain de vivre en parfaite harmonie avec lui-même et avec Dieu. On peut aussi envisager le personnage principal comme un homme en conflit avec les valeurs de sa société et dont la quête spirituelle évoque un problème existentiel profond. Ce roman anticipe ainsi sur le thème du conflit identitaire qui jalonne tout le roman africain postcolonial. Notre propos n’étant pas d’en faire la critique, nous nous limitons à souligner, comme le note Daniel Kunene dans son analyse des romans de Mofolo, que ce premier roman en langue vernaculaire africaine est une allégorie écrite dans une « langue et un style excellents » (Kunene, 1970 : 5).
Les deux autres romans de Mofolo écrit par la suite sont d’un style différent, puisque le christianisme n’en est pas le centre. Par contre, ils sont tous les deux également rédigés en sésotho. Il est utile de noter que le choix d’écrire en langue vernaculaire africaine n’est pas légion à cette époque de naissance et de développement des littératures africaines. Le cas de Sol Tshekisho Plaatje (1876-1932) est révélateur à cet égard. En effet, si Mofolo est le premier Africain à écrire un roman, Plaatje est le premier Africain à écrire un roman en anglais : Mhudi, an Epic of South African Native Life a Hundred Years Ago (1930). Écrit en 1915 mais publié seulement en 1930, ce roman raconte l’histoire de deux personnages (l’un féminin, Mhudi, et l’autre masculin, Ra-Thaga), dont la tribu, les Barolong, est victime des représailles d’un peuple voisin, les Ndébélé. Ils errent dans le bois à la recherche du salut et finissent par devenir compagnons de vie. Il s’agit d’une fable primitive qui rappelle l’origine de la violence dont ont longuement souffert les Noirs d’Afrique du Sud tout en célébrant le rôle primordial et la bravoure de la femme en temps de guerre. L’objectif principal de Plaatje est de dénoncer l’atrocité de l’apartheid et du racisme en Afrique du Sud bien avant leur reconnaissance officielle en tant que méthode discriminatoire de gestion étatique. Comme le note Bryan Willan dans Sol Paatje, South African Nationalist 1876-1932, c’est peut-être par opposition au caractère brutal et d’inhumanité de l’oppression exercée par les Blancs en Afrique du Sud qu’il a écrit ce récit que lui-même qualifie modestement d’histoire d’amour et de romances basée sur des faits historiques (Willan, 1984 : 349).
Au-delà de l’engagement à la fois politique et littéraire dont l’auteur fait preuve à travers cette œuvre, c’est le choix linguistique qu’il fait en écrivant en anglais qui pose question. On sait qu’il a été nourri par l’histoire et les légendes des Barolong, tribu dont il est lui-même issu et dont il parle couramment la langue. Pourquoi n’a-t-il donc pas écrit en langue locale, d’autant plus que la maison d’édition Lovedale (où paraît son roman) et les presses missionnaires de Morija publiaient déjà des pamphlets en langues sud-africaines, en particulier en xhosa et sotho, pour la propagande du christianisme ?
Brian Willan remarque que l’engagement de Plaatje dans la lutte pour la préservation de la culture, en particulier des langues et littératures sud-africaines ne fait l’objet d’aucun doute. D’ailleurs, il tenait un journal en tswana à travers lequel il se donnait l’ambition de développer et perpétuer l’écriture et la littérature tswanas. Par contre, le développement de cette écriture fut confronté à un problème de transcription phonétique et orthographique (Willan, 1984 : 325). L’ampleur du problème était telle que chacune des quatre sociétés missionnaires présentes en Afrique du Sud a proposé son propre registre. Comme Plaatje n’était satisfait d’aucun d’eux, il créa son propre système de transcription, ce qui lui permit par la suite de traduire des textes européens en tswana, notamment The Comedy of Errors de William Shakespeare, traduit sous le titre de Diphosho-phosho (1930).
Malheureusement, cet effort de valorisation et de pérennisation des langues vernaculaires africaines n’a pas été poursuivi par les écrivains africains ; l’entreprise a été délaissée, en particulier par ceux de la deuxième génération. Ces écrivains, dont les textes se réclamaient clairement d’un discours anticolonial, et qui s’opposaient à l’exploitation du continent africain et à l’infériorisation du Noir, ont majoritairement utilisé la langue du colonisateur. Dans les écrits des Nigérians Wole Soyinka, Chinua Achebe et Amos Tutola ou des Ghanéens Ayi Kwei Armah, Efua Sutherland, Ama Ata Aidoo et Kofi Awonoor, pour ne citer qu’eux, on note l’adoption de la langue anglaise à la fois comme outil de communication et arme de lutte contre la déculturation (l’acculturation). Cependant, ces écrivains n’oubliaient pas pour autant que cette langue leur était imposée par le système impérial qui estimait que la langue métropolitaine était la norme à suivre et donc percevait, ainsi que l’écrivent Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin, toute variation comme une « impureté » linguistique (Ashcroft, 1984 : 7). Certains parmi eux ont risqué, avec succès, de se réclamer de cette impureté (notamment Amos Tutola et Okot p’Bitek) alors que d’autres se sont limité à proposer des solutions pour l’avenir des littératures africaines. Par exemple, tout en plaidant pour la promotion des langues vernaculaires africaines, Ayi Kwei Armah milite pour l’adoption d’une langue continentale de référence. Évoquant des raisons géographiques et lexicales, le kiswahili, langue vernaculaire d’Afrique de l’Est, serait, selon lui, un choix judicieux (Armah, 2010 : 129). Or, Armah, auteur de huit romans et de plusieurs nouvelles et essais en langue anglaise, n’a jusque-là produit aucune œuvre dans sa langue maternelle, ni même en kiswahili. En attendant que le vœu qu’il a exprimé (et qui relèverait d’un choix politique continental) soit envisagé, d’autres écrivains, hélas peu nombreux, ont adopté une attitude plus pragmatique, prenant la décision de délaisser la langue du colonisateur pour écrire en langues africaines.
En la matière, l’un des cas les plus probants est sans doute celui de l’écrivain kenyan Ngugi Wa Thiong’o. Auteur de romans, nouvelles, pièces de théâtre et essais, cet écrivain prolifique a publié ses premiers écrits en anglais, comme la plupart des écrivains africains, avant de se tourner vers l’écriture en langues africaines. Ngugi a compris l’impact dévastateur de l’anglais sur la culture kenyane et a décidé d’aider à la promotion d’une littérature en kikuyu et en swahili. L’acte fondateur de cette prise de conscience est sans doute le changement de son prénom de James à Wa Thiong’o. Par la suite, il défendra l’idée que la langue n’est pas qu’un instrument de communication, elle est également porteuse de l’histoire et la culture de chaque peuple (Ngugi, 1993 b : 30). Des deux fonctions fondamentales de la langue soulignées par Ngugi, c’est-à-dire la communication et la transmission de l’histoire et de la culture, la seconde pose problème aux écrivains africains qui écrivent en langues étrangères au détriment de celles de leur continent. Leur rôle de courroie de transmission de l’héritage culturel ne peut être convenablement rempli s’ils continuent d’écrire exclusivement dans des langues européennes. Pour Ngugi, seuls les Africains qui se sentent encore colonisés et endoctrinés continuent de voir les langues européennes comme des outils de communication par excellence. C’est pour cette raison qu’il propose une décolonisation de l’esprit de l’écrivain qui a tendance à n’écrire que pour les intellectuels africains et les occidentaux alors que la population locale devrait être son audience prioritaire. Les différentes articulations de cette argumentation sont développées dans son ouvrage Decolonising the Mind dans lequel il se refuse à prendre part à une littérature qu’il qualifie d’afro-européenne (Ngugi, 1986 a : 26).
Ce n’est pas seulement le discours anticolonial et le combat contre le néo-colonialisme qui se perçoit à travers sa prise de position. En effet, on note dans cet appel une rupture révolutionnaire, une réelle détermination à faire éclore une littérature vernaculaire africaine. Depuis 1977, soit après dix-sept ans d’écriture en langue anglaise, Ngugi écrit en kikuyu. Ngaahika Ndeenda: Ithaako ria ngerekano (I Will Marry When I Want), pièce écrite en collaboration avec Ngugi wa Mirii) en 1980 et, deux ans plus tard, le roman Caitaani mutharaba-Ini (Devil on the Cross) sont les premières publications directement écrites dans sa langue maternelle ; elles dénotent une prise de conscience intégrant la langue comme instrument primordial du développement d’une littérature africaine en langues africaines.
Il est utile de noter qu’une telle ambition est presque absente des priorités gouvernementales des hommes politiques qui ont pris les rênes du pouvoir étatique après l’obtention des indépendances africaines. Seul l’ancien président tanzanien Julius Nyerere (1922-1999), qui, dans sa volonté de promouvoir une culture populaire dans son pays, a traduit deux pièces de Shakespeare en swahili, fait exception à ce constat. Quoique regrettable, ce manque d’engagement politique ne suffit pas à faire passer aux oubliettes les efforts des écrivains de l’Afrique anglophone qui se sont intéressés aux langues africaines. Une même détermination existe également dans les pays africains dits francophones ; par contre, comparée aux anciennes colonies anglophones où nous pouvons noter une prise de conscience ferme, elle semble amorphe à plusieurs égards.
b) De L. S. Senghor à Alain Mabanckou : une lente émergence de l’écriture en langues africaines dans l’espace francophone
Tout comme l’Afrique anglophone, l’Afrique francophone possède des écrivains de premier plan. Alors que la qualité des œuvres des écrivains africains d’expression anglaise a été reconnue par la communauté littéraire internationale avec les prix Nobel de littérature décernés à Wole Soyinka (1986), Nadine Gordimer (1991) et John Maxwell Coetzee (2003), la littérature africaine d’expression française est marquée par l’émergence des écrivains ouest-africains tels que les sénégalais Léopold S. Senghor et Sembène Ousmane, les ivoiriens Bernard Dadié et Ahmadou Kourouma ainsi que le malien Amadou Hampâté Bâ. Ces auteurs ont produit des œuvres de qualité, mais n’ont pas acquis la notoriété implacable de leurs homologues anglophones. Ce qui est remarquable chez la plupart de ces écrivains, c’est leur détermination à écrire dans une langue française soignée et raffinée. D’ailleurs, s’ils souhaitaient publier dans les maisons d’édition occidentales, ils n’avaient pas le choix d’écrire dans une langue lisible par le Français de la Métropole.
Le problème de l’écriture en langue africaine a été peu posé par les premiers écrivains africains de langue française. On note une africanisation de la langue à travers les œuvres des écrivains tels que Sony Labou Tansi et Ahmadou Kourouma, notamment dans le premier roman de ce dernier, Les Soleils des Indépendances (1970), qui s’offre comme le reflet de la langue et culture malinké. Ces exemples, qui témoignent d’une réelle volonté de décrire le monde africain tel qu’il apparaît aux écrivains, ne suffisent pas à fonder à une littérature africaine en langues vernaculaires africaines. Comme on le sait, il y a une énorme fierté et une forme de dignité culturelle pour une littérature à produire de longs textes en prose ou en vers. Malheureusement, en parcourant les premiers textes littéraires du monde francophone africain, on remarque qu’il n’y a pas de textes en langues africaines comparables aux Chants d’ombre de Senghor ou aux romans de Mofolo. Selon Alain Ricard, un prix aurait été attribué en 1952 lors de la foire de Bruxelles à un texte en français et un autre à un roman en langue africaine (kinyarwanda). Cependant, ses efforts pour en retrouver trace ou preuve d’existence (soit le manuscrit, soit le livre publié) sont restés infructueux. Après les indépendances africaines, seuls le congolais Pius Ngandu Nkashama, auteur de plusieurs romans en ciluba, et le sénégalais Boubacar Boris Diop, qui écrit en wolof, ont produit des œuvres relativement comparables à celles de Ngugi Wa Thiongo’o. Par contre, l’impact de cette pratique, qu’on qualifierait d’expérimentale dans la communauté littéraire et linguistique de l’Afrique francophone, reste limité. De même, en l’absence de traductions et de critiques de ces œuvres, il est difficile de juger de leur valeur littéraire.
Peut-être, peut-on affirmer sans détour que l’écriture en langues africaines est loin d’être une priorité dans les territoires anciennement colonisés par la France. En effet, alors que la Bible existe dans la plupart des langues africaines, les premiers intellectuels africains n’ont cessé de percevoir le français comme la langue de communication par excellence. Ainsi, quand la question de son choix de la langue française comme langue d’écriture a été posée à Senghor, ce dernier répond :
Parce que nous sommes des métis culturels, parce que, si nous sentons en nègres, nous écrivons en français, parce que le français est une langue à vocation universelle, que notre message s’adresse aussi aux Français de France et aux autres hommes, parce que le français est une langue de gentillesse et d’honnêteté. (Senghor, 1956 : 12).
Ainsi, pour Senghor, les Africains n’ont pas épousé uniquement la culture de la France, ils en ont également adopté la langue. Est-il possible d’oublier qu’il s’agit là de l’effet de l’impérialisme subi par l’Afrique, qui a débouché, de façon paradoxale, comme le note Frantz Fanon dans Les Damnés de la terre, sur le consentement de l’indigène (Fanon, 2002 : 46) ? Devons-nous trouver, dans l’expression de cette profession de foi clairement favorable à la langue française, un mimétisme ou un rejet de soi ? Certes, le contexte de cet enthousiasme débordant est familier. En effet, pendant la colonisation, la langue française n’était plus de façon exclusive la langue des Français ; devenue également la propriété des peuples colonisés, elle s’offrait comme un instrument de promotion et de réhabilitation des valeurs culturelles africaines. À cet égard, et compte tenu de sa contribution à l’émergence d’une culture africaine, on n’est pas surpris que la carrière littéraire de Senghor ait été récompensée par son entrée à l’Académie française, même s’il s’agit d’une institution dans laquelle il ne s’est jamais exprimé en sérère, sa langue maternelle.
Parallèlement à cette reconnaissance du talent littéraire de l’auteur de l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française (1948), et contrairement à l’attitude générale des écrivains majeurs de l’aire anglophone, il nous semble que la relation conflictuelle avec la langue du colonisateur est presque passée sous silence par les écrivains des premières et deuxièmes générations de l’espace francophone. Du moins, l’expression de ce malaise est complètement annihilée par le manque de pugnacité de ceux qui continuent de vivre leur rapport avec les langues étrangères comme un « drame linguistique » (Memmi, 1985 : 125) duquel ils ne peuvent échapper. Il n’est donc pas surprenant que la plupart des écrivains des anciennes colonies continuent encore de nos jours à exprimer leur attachement à la langue française, ou alors leur impossibilité à s’en éloigner. Alain Mabanckou, écrivain franco-congolais, fait partie de cette catégorie. Écrivain talentueux ayant eu une présence remarquable dans la communauté littéraire africaine et internationale depuis le début des années 1990, il s’est exprimé sur l’omniprésence du français comme langue d’écriture et sur l’émergence de l’écriture en langues africaines. Il s’insurge contre la position du Camerounais Patrice Nganang qui propose que les Africains écrivent désormais « sans la France » (Nganang, 2004) pour ne pas cautionner l’idéologie coloniale : « En se lançant dans de telles polémiques, les auteurs africains n’escamotent-ils pas le vrai sujet : la littérature ? » (Mabanckou, 2012 : 136)
En réalité, le problème posé par le courant africaniste des écrivains d’expression française, et esquivé avec subtilité par Mabanckou, n’est pas celui du talent littéraire, mais de l’identité de la littérature faite par les écrivains, nouveaux passeurs de culture par excellence du continent africain. Si l’idée et l’exigence d’écrire en langues vernaculaires africaines s’imposent de plus en plus avec insistance, ce n’est sans doute pas seulement, comme le pense Mabanckou, parce que « le français serait entaché d’un vice rédhibitoire, insurmontable, inexcusable : c’est la langue du colonisateur » (Mabanckou, 2012 : 138) ou parce que le français ne permettrait guère aux écrivains africains de s’exprimer avec authenticité ; c’est parce que les langues elles-mêmes font partie de la culture africaine. N’en faire donc qu’un usage oral reviendrait à reléguer au second plan toute l’histoire qu’elles portent et les mutations qu’elles sont sensées exprimer.
III. La traduction : une alternative à l’émergence d’une littérature en langues africaines
L’Afrique a produit et continuera sans doute de produire des écrivains aussi talentueux que Soyinka, Senghor, Ngugi, Kourouma ou Mabanckou. Par contre, si la nouvelle génération de passeurs de culture (tous registres confondus, c’est-à-dire écrit et oral, en langues africaines, en français ou en anglais), contrairement à celle des négritudiens, souhaite voir éclore des Africains écrivant en langues africaines, il faut promouvoir ces langues en leur donnant toute la place qui leur revient. Autrement dit, une véritable politique linguistique (système graphique, grammaire, académies, journaux revues, etc.) s’impose aux autorités politiques et à l’ensemble des hommes de culture africains. En effet, si nous nous limitons au cas de l’écriture, nous pourrions affirmer, de toute évidence, qu’il n’y a aucun intérêt à écrire dans une langue que personne ne lit. Or, jusqu’en ce début du XXIe siècle, très peu de personnes sont capables de lire en langues africaines. C’est sans doute pour cette raison que l’éclosion d’écrivains en langues vernaculaires africaines est lente. Une véritable prise de conscience linguistique est donc nécessaire au sein du continent africain.
Quelques solutions ont été envisagées et mises en pratique par des africanistes et des écrivains africains afin d’aider à poser les bases de l’émergence d’une littérature en langues africaines. Parmi celles-ci, la traduction est la plus fréquente. En effet, comme nous l’avons déjà souligné, de nombreux textes occidentaux de référence (en particulier la Bible) ont été traduits dans presque toutes les langues d’Afrique. Après les missionnaires, des hommes de culture africains ont tenté de démystifier l’acception commune selon laquelle seuls l’anglais et le français sont les vecteurs de diffusion du savoir. Par exemple, Shakespeare a été traduit dans les langues de Afrique australe et de l’Est (notamment par Nyerere et Plaatje) et Le roi s’amuse de Victor Hugo a été traduit en kiswahili au Kenya par l’universitaire congolais Marcel Kalunga Mwele. Par contre, les traductions de textes des langues africaines aux langues occidentales sont rares. C’est ce phénomène de choix et d’exclusion qu’Alain Ricard nomme « traduction et apartheid » dans Le Sable de Babel, car il y a un double mouvement qui consiste à choisir et traduire ce que l’on veut faire lire et écrire (traduction) et à mettre de côté le reste (apartheid) : les textes en langues africaines. Il s’agit donc d’une discrimination textuelle qui montre, comme le souligne Robert J.C. Young, que pendant la colonisation et sous l’apartheid, la traduction ne s’offrait pas comme un acte d’échange, elle faisait plutôt partie du processus de domination (Young, 2003 : 140-1). Il s’agit donc d’un rapport de force qui s’oppose à l’égalité et à l’hospitalité linguistiques (Ricard, 2011 a : 393) qui auraient pu promouvoir un dialogue interculturel. Ricard note à ce sujet :
En traduisant, nous avons graphisé les langues de l’Afrique et créé les conditions d’écriture dans ces langues. Une forme de conversation s’est engagée. Cette graphisation a permis à des auteurs de naître, d’écrire des romans et des essais dans leur langue, mais nous ne les avons pas traduits, nous les avons ignorés. (Ricard, 2011 b :25)
Certes, durant la colonisation, écrire en langues africaines était perçu comme un acte de résistance. De ce fait, les colons et les missionnaires ont pratiquement ignoré la littérature faite par les écrivains africains tels que Mofolo, qui étaient animés d’une double volonté : s’exprimer dans une langue authentique et préserver leur langue maternelle. Mais, on se rend compte qu’une prise en compte de ces textes aurait pu changer le regard des Occidentaux sur l’Afrique et éventuellement sur eux-mêmes. Le même constat peut être fait du rapport de l’Africain à lui-même : les textes africains n’auraient-ils pas pu permettre aux Africains de mieux se connaître afin de mieux appréhender l’Autre ? Conscients de ce fait, des africanistes se sont engagés, depuis quelque temps, dans un combat de reconnaissance culturelle des langues africaines en se saisissant de certains de ces textes pour les traduire. Nous pouvons rappeler le cas de Mofolo, dont les romans écrits en sotho entre 1905 et 1910 ont été traduits en anglais par Daniel Kunene (en 1981) et, Harry Ashton (en 2007), ainsi que le cas de Wole Soyinka, qui a traduit du yoruba en anglais un texte de son compatriote Daniel Fagunwa sous le titre de The Forest of a Thousand Daemons (1968).
Dans le même souci de résoudre le problème de la marginalité exotique dans laquelle sont reléguées ces langues, on peut souligner l’effort de certaines institutions internationales pour promouvoir la traduction afin d’aider à la vulgarisation des langues marginalisées. Tel est le cas du Centre International d’ Écriture et de Traduction (ICWT) de l’université de Californie, créé en 2001, qui a organisé un colloque sur les langues marginalisées en 2007. Par ailleurs, certains écrivains, ayant acquis leur renommée grâce à leurs œuvres écrites dans la langue du colonisateur, ont ensuite recours à l’auto-traduction afin que leurs œuvres soient lues aussi bien en langues africaines qu’en anglais ou en français. En la matière, Ngugi Wa Thiong’o fait office de pionnier : ses livres en gikuyu sont suivis d’une traduction en anglais. De même, s’il est facile de constater que les anciennes colonies françaises, notamment celles de l’Afrique de l’Ouest, sont les régions où l’écriture en langues africaines est plus réduite, on peut néanmoins souligner le combat du sénégalais Boubacar Boris Diop qui écrit en wolof et s’auto-traduit en français, tout comme le fait l’écrivain peul Amadou Hampâté Bâ.
Les traducteurs, dont le rôle premier est de favoriser la conversation entre les langues et les cultures (qu’elles soient marginalisées ou dominantes), sont peu nombreux sur le continent africain. C’est pour cette raison qu’on est tenté de se réjouir de l’avènement des écrivains qui s’auto-traduisent. Cependant, on ne peut s’empêcher de souligner, à la suite de Ricard, que « l’auto-traduction simultanée, ou retardée, est une pratique qui sape l’autorité de la langue africaine sous couvert d’une promotion. Elle est la reconnaissance d’un rapport de force, dépassé seulement par une solution individuelle » (Ricard, 2011 a : 372). Dès lors, nous comprenons pourquoi certains écrivains africains, en particulier l’écrivain tanzanien Ebrahim Hussein, refusent désormais de la pratiquer. Ce dernier, jadis obligé de n’exister qu’à travers l’auto-traduction, revendique ainsi son statut d’écrivain comme les autres. Peut-être, est-ce une manière pour lui d’inciter tous ceux qui s’intéressent à l’Afrique et à sa littérature à apprendre à parler et à écrire les langues africaines, comme cela se fait déjà en Allemagne et aux Etats-Unis ? Pour Ricard, « cela n’a rien à voir avec une efficacité à court terme mais avec une forme de respect : les cultures de l’Afrique donnent souvent lieu à des enthousiasmes qui méritent d’être testés pratiquement par l’étude d’une langue » (Ricard, 2011 b : 24).
Conclusion
Poser le problème du dilemme linguistique des écrivains africains en ce début de XXIe siècle revient à actualiser le débat sur les modes et outils d’expression des intellectuels des anciennes colonies françaises et anglaises. Beaucoup a déjà été dit et écrit sur cette question mais, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle reste pour l’instant inépuisée. En effet, alors que l’oralité, qui caractérise les cultures de ce continent, n’a pas tout à fait disparu, l’écriture s’est ostensiblement imposée, à cause de l’impérialisme culturel que subissent les passeurs de culture africains depuis plus d’un siècle. Si certains écrivains (hier Senghor, aujourd’hui Mabanckou) se réconfortent de l’idée de pouvoir préserver leur héritage culturel grâce aux langues du colonisateur, d’autres comme Ngugi, Nyerere ou Boubacar Boris Diop pensent qu’il y a un terrible décalage entre la façon d’être des Africains (leur joie de vivre, leur humour, la verdeur de leur expression) et l’image que donnent d’eux leurs écrivains à travers l’usage des langues occidentales.
Pour exprimer le flux de leur pensée avec plus d’authenticité tout en préservant l’histoire que portent les cultures africaines, la tendance est désormais d’encourager les nouvelles générations d’Africains à écrire dans leurs langues maternelles. En effet, selon Boubacar Boris Diop, « le français – ou l’anglais – est une langue de cérémonie et ses codes, à la fois grammaticaux et culturels, ont quelque chose d’intimidant » (Diop, 1999). Cependant, comme nous avons pu le montrer dans notre analyse, il y a une différence entre réussir à poser le problème et trouver un remède efficace. Sans toutefois négliger l’impact des pionniers des littératures sotho, swahili ou wolof, on constate que le chemin à parcourir pour développer une véritable littérature en langues vernaculaires africaines est encore long. En attendant une véritable prise de conscience continentale, à la fois politique et culturelle, la seule alternative pour résister à la damnation culturelle et à l’enfermement de ces écrivains est la traduction de leurs œuvres dans d’autres langues (dominantes ou marginalisées). Les intellectuels, les hommes de culture et les écrivains, qui ont pris le relais du griot dans la transmission de l’héritage culturel, doivent intensifier leur engagement s’ils souhaitent que le français et l’anglais ne soient plus perçus comme seuls vecteurs de modernité. La construction d’un corpus littéraire qui aiderait à réduire l’impact de l’hégémonie linguistique et culturelle de l’Occident en dépend.
Works Cited
Armah, Ayi Kwei. Remembering the Dismembered Continent. Popenguine: Per Ankh, 2010.
Ashcroft (Bill), Griffiths (Gareth), Tiffin (Helen). The Empire Writes Back. Theory and Practice in Post-colonial Literatures. London : Routledge, 1989.
Césaire, Aimé. Cahier d’un retour au pays natal. Paris : Présence africaine, 1983.
Chevrier, Jacques. L’Arbre à palabres. Essai sur les contes et récits traditionnels d’Afrique noire. Paris : Editions Hatier International, 2005.
Diop, Boubacar Boris. “A l’écoute de Boubacar Boris Diop.” Entretien de Boubacar Boris Diop avec Jean-Marie Volet, Mots Pluriels 9 (2009). En ligne : http://motspluriels.arts.uwa.edu.au/MP999bbd.html [consulté le 15 octobre 2013]
Fanon, Frantz. Peau noire, masques blancs. Paris : Editions du Seuil, 1952.
Fanon, Frantz. Les Damnés de la terre. Paris : Editions La Découverte / Poche, 2002.
Hale, Thomas A. “Griottes: Female Voices from West Africa”. Research in African Literatures, 25.3 (1994): 71-91.
Haley, Alex. Roots: the Saga of an American Family. New York: Doubleday and Company, 1976.
Kourouma, Ahmadou. Les Soleils des indépendances. Paris: Editions du Seuil, 1970.
Kunene, Daniel P. “The Works of Thomas Mofolo: Summaries and Critiques.” Occasional Paper, Occasional Papers Series 2, James S. Coleman African Studies Center (University of California), (1970): 18 pages. En ligne: http://escholarship.org/uc/item/22w2c729. [Consulté le 15 octobre 2013]
Mabanckou, Alain. Le Sanglot de l’Homme Noir. Paris, Fayard, 2012.
Mofolo, Thomas. Moeti oa bochabela. Morija: Morija Sesuto Book Depot, 1907.
Traduction anglaise par Harry Ashton: Traveller to the East. Johannesburg: Penguin Books, 2007.
Memmi, Albert. Portrait du colonise précédé de Portrait du colonisateur. Paris : Gallimard, 1985.
Nganang, Patrice. “Ecrire sans la France.” Africultures 60 (21 novembre 2004). En ligne : http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=3610. [Consulté le 2 octobre 2013]
Ngugi, Wa Thiong’o. Decolonising the Mind. The Politics of Language in African Literature. London: Heinemann, 1986.
Ngugi, Wa Thiong’o. Moving the Centre. The Struggle for Cultural Freedoms. London: Heinemann, 1993.
Nkosi, Lewis. Tasks and Masks. Themes and Styles of African Literature. London: Longman, 1981.
Plaatje, Sol T. Mhudi, an Epic of South African Native Life a Hundred Years Ago. Johannesburg: Lovedale Press, 1930.
Senghor, Léopold Sédar. Ethiopiques. Paris : Editions du Seuil, 1956.
Senghor, Léopold Sédar. Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française. Paris: Presses Universitaires Françaises, 1948.
Ricard, Alain. Le Sable de Babel: Traduction et apartheid. Paris : CNRS éditions, 2011.
Ricard, Alain. “La traduction est une forme d’hospitalité linguistique”. Interview réalisé par Kidi Bebey, Francophonies du Sud 27, novembre 2011, 24-25.
Willan, Brian. Sol Plaatje. South African Nationalist 1876-1932. Berkeley – Los Angeles: University of California Press, 1984.
Young, Robert J.C. Postcolonialism. A very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2003.