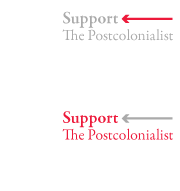Recently elected to the Académie française, Dany Laferrière is a Haitian and Canadian novelist and journalist. The Postcolonialist editor Pénélope Cormier interviewed him on October 10, 2013, just before his candidacy was announced. An English translation of the interview is provided below.
The Postcolonialist : Notre revue s’intéresse aux productions artistiques qui transcendent de façon novatrice les frontières et les identités nationales. Votre parcours entre Haïti, Montréal et les États-Unis est exemplaire en ce sens. On a souvent tendance à catégoriser spatialement les auteurs; ainsi, vous avez tour à tour été décrit comme écrivain haïtien, québécois, exilé, de la diaspora, migrant, etc. Que pensez-vous de ces différentes étiquettes ? Ont-elles leur utilité ou cachent-elles l’essentiel ?
Dany Laferrière : Il est vrai que j’ai souvent à répondre à cette question. Parfois, je me la pose moi‑même. Mais j’avoue en avoir marre de toutes ces étiquettes, parce qu’elles ne servent à rien, c’est‑à‑dire qu’elles ne servent qu’à la personne qui les propose, et pour un temps seulement. Par exemple, l’université a un travail précis à faire et la catégorisation des auteurs lui permet de mieux les cerner, comme le papillon mort est plus facile à examiner. En réalité cependant, les étiquettes littéraires et politiques se contaminent facilement et brouillent les pistes ; c’est souvent le cas, en particulier, pour les littératures migrantes.
TP : Vous évoquez souvent, dans vos œuvres, l’ambiguïté de votre rapport avec Haïti, un rapport rempli à la fois d’une certaine forme de culpabilité, mais surtout de légèreté : « Je traverse le monde, en sifflotant, laissant derrière moi une île à la dérive. Sans jamais l’oublier, j’ai su dès le départ qu’il fallait m’en distancer pour qu’elle ne m’entraîne pas dans sa spirale. Pour aider quelqu’un à sortir d’un trou, il ne faut pas s’y trouver avec lui. Me voilà, avec pour toute fortune au fond de ma poche les vingt-six lettres de l’alphabet. » (Journal d’un écrivain en pyjama, p. 16-17) Cette légèreté, ou désinvolture, serait-elle représentative de votre rapport à toutes ces identités ?
DL : C’est une question très vaste, à laquelle j’ai consacré des livres entiers. Il y a des situations assez sanglantes en Haïti, qu’on ressent d’autant plus comme telles quand on vit dans une ville plutôt calme, comme Montréal. Mais la culpabilité, ce n’est pas mon genre. Je me souviens qu’après le séisme [ndlt : le tremblement de terre en Haïti, survenu le 12 janvier 2010], mes amis écrivains se demandaient si on ne devait pas se sentir coupable d’être vivant quand toutes ces personnes étaient décédées. Je tenais plutôt ce raisonnement : en aucun cas les gens qui sont morts voudraient qu’on soit morts avec eux. Personne ne souhaite de malheur aux autres parce qu’ils sont dans le malheur. Alors, je n’entretiens pas de rapport de culpabilité avec Haïti.
Ma relation avec Haïti peut sembler complexe si on mélange la vie personnelle et la littérature. Il ne faut pas confondre ce qui est dit dans mes œuvres avec ma réalité. Mon écriture ratisse large, essaie de rendre toutes sortes d’émotions de gens différents, également Haïtiens et exilés. Leurs expériences sont mises à contribution dans mes œuvres. Comme je sais qu’il y a des gens qui se sentent coupables d’être à l’extérieur d’Haïti, il arrive qu’il y ait des traces de cette culpabilité dans mes livres. Je donne toujours priorité au livre ; quand j’ai envie de réfléchir sérieusement à quelque chose, j’écris un livre. Cela me permet d’explorer plusieurs angles de la question, parce que la vie est un kaléidoscope.
TP : Est-ce que la consécration littéraire que vous avez obtenue au Québec se traduit par un sentiment d’appartenance?
DL : Encore une fois, je fais la distinction entre la vie personnelle et la littérature. Bien sûr, j’écris au Québec, je publie au Québec, tous mes livres ont paru d’abord dans les éditions québécoises avant de paraître ailleurs. Cependant, je me considère comme un écrivain international, sans formalité, dans le sens que, pour moi, la promesse de la littérature est l’universalité. J’écris pour comprendre ce que je vis et je partage mes sentiments, mais pour découvrir en même temps que c’est la situation de l’ensemble des gens qui vivent sur cette planète. En fait, je ne suis pas seul ; c’est ça, la promesse de la littérature. Vous n’êtes pas seul. Quand on gratte la petite couche folklorique des individus, on s’aperçoit que les sentiments humains sont pareils. Je ne cherche pas à me décrire par ma littérature, je cherche à écrire ce que je ressens.
Quant à cette intégration à l’espace québécois, il est vrai que je la fais au niveau citoyen. Je participe à ce qui se passe au Québec, je suis sensible aux événements qui nous arrivent, aux débats qui nous touchent, bref à la réalité quotidienne.
TP : Vous rassemblez une bonne part de votre œuvre, de votre premier roman, Comment faire l’amour à un Nègre sans se fatiguer (1985), au Cri des oiseaux fous (2000), dans ce que vous appelez une « autobiographie américaine ». Au-delà de l’espace continental, qui est arpenté dans ces œuvres, on peut les classer en récits de l’enfance (ou de la mémoire) et récits contemporains. Est-ce que les divers espaces continentaux ont changé de signification avec le passage du temps ?
DL : Je fais une précision : cette histoire d’une « autobiographie américaine » en dix volumes vient de moi. J’en avais marre d’entendre les gens dire qu’il y avait dans mes romans, d’un côté, un personnage au cœur sensible et avec une affection sincère pour sa famille, qui se retrouvait dans les romans qui se passent en Haïti et, de l’autre, une sorte de prédateur international, un personnage urbain sensible à l’écriture nord-américaine, qui se trouve dans les romans qui se passent en Amérique du Nord (notamment Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer et Cette grenade dans la main du jeune Nègre est-elle une arme ou un fruit ?). Je voulais rassembler ces positions à première vue divergente, pour faire comprendre à mes lecteurs, et surtout aux étudiants qui analysent mes œuvres – je les en remercie par ailleurs –, qu’il s’agit en fait de la même personne, d’un même travail, de la même Amérique, que Port-au-Prince et Petit-Goâve sont aussi des villes de ce continent. « Autobiographie américaine » ne veut pas dire les États-Unis, mais ce continent-là, une traversée par une histoire singulière, comme par la politique, l’économie, le racisme et tous les éléments qui déterminent cette partie du monde. Je voulais dire tout cela de façon simple, pour empêcher qu’on coupe mon œuvre, qu’on en travaille la partie haïtienne et la partie nord-américaine séparément. Pensant que je n’écrirais peut-être pas d’autre livre, j’ai dit que mes dix romans formaient une « Autobiographie américaine » ; c’était simplement une petite stratégie du moment. Ensuite, j’ai continué à écrire, et mes livres continuent à se retrouver dans cette grande chaudière. Je ne vois pas pourquoi Pays sans chapeau (1996) y figurerait et pas L’énigme du retour (2009).
Ensuite, les analystes, les critiques, les gens qui étudient les livres sont bien sûr libres de tout, même de contester ce que je dis. Je ne suis pas du tout la référence pour mes livres. Je donne des précisions techniques, ce qui n’invalide pas les autres analyses. Je tiens cependant à dire de faire attention quand on emploie des mots comme « mémoire », de ne pas faire une histoire personnelle. Il n’y a pas d’écrivain qui ne soit un écrivain de la mémoire. Ça n’existe pas. On ne peut pas écrire autre chose que ce qui nous habite, et ce qui nous habite, c’est d’abord le temps qui passe. J’ai l’impression qu’on réserve « la mémoire » aux gens qui sont en exil, comme si la mémoire était seulement liée à l’espace, au déplacement. Comme si le temps n’existait pas, que l’espace était la seule chose à définir, à déterminer la mémoire, alors qu’on peut rester dans la même ville, le même quartier, la même maison et avoir une mémoire du temps qui passe, et la nostalgie du temps qu’on ne pourra pas rattraper. On écrit avec tant de choses.
TP : Dans Le cri des oiseaux fous, votre narrateur fait la distinction entre engagement politique et engagement culturel. Son action se situe principalement du côté de la culture, par l’affirmation de l’indépendance d’esprit comme forme de résistance au pouvoir, sans doute la meilleure possible puisque, justement, elle ne s’occupe pas de pouvoir. Pouvez-vous développer cette position?
DL : C’est le cas dans une dictature. Dans les villes complètement capitalistes d’Amérique du Nord, c’est plutôt le collectif qui est une forme de résistance. Le dictateur, lui, a volé le sens collectif, l’a pris en otage et naturellement voudrait qu’on se soumette à lui un à un. Il y a peu de choses pouvant soumettre les individus autant que la peur. La peur est une chose individuelle. Le rêve du dictateur est d’intégrer, dans chaque individu, cette peur. Dans ce contexte, il ne faut donc pas perdre de vue que le plus résistant, c’est encore l’individu. Il faut commencer par être résistant soi-même si l’on veut ensuite se regrouper dans la résistance. Ce que le dictateur veut faire, c’est d’abord nous annuler, nous humilier et faire en sorte que nous perdons toute individualité. C’est pour cela qu’il y a beaucoup de choses qui sont liées, que ce soit dans la colonisation ou la dictature, à l’humiliation personnelle. On veut vous humilier. Dans les pays plus industrialisés, on veut tout simplement voler votre énergie, pas forcément vous humilier individuellement. On veut vous réduire au suicide, ou à des ensembles collectifs pour capter votre énergie et la convertir en argent, en puissance. On ne cherche pas à vous humilier : votre position est déjà humiliante d’être dans cette collectivité qu’on fait travailler dans des conditions difficiles. Mais dans les dictatures, puisqu’on n’offre pas de travail, il n’y a pas de classe ouvrière. Il faut prendre les individus un à un. C’est ça la résistance, l’individu est le premier rempart. Si vous vous laissez occuper par la peur que le dictateur veut situer en vous, il n’y a aucune possibilité de résistance.
TP : La littérature peut-elle avoir une fonction similaire dans les pays « du Nord » et « du Sud » ? Comment les fonctions, ou les préoccupations, de la littérature, à Haïti et au Québec, peuvent-elles se rejoindre ?
DL : Pour ma part, je reste plongé dans la chose elle-même, la littérature. Quand on passe la plupart de son temps à ferrailler avec des adjectifs ou des adverbes, on n’a pas trop le temps de regarder les choses sous cet angle-là. C’est plutôt le rôle des universités de s’interroger sur ce qui est différent et ce qui est semblable. Bien sûr, il y a un aspect universel de la littérature. Les sentiments, les émotions, la résistance individuelle qu’on a vu depuis Antigone de Sophocle. Quand Antigone dit : « Je ne suis pas ici pour la haine, je suis ici pour l’amour », c’est un peu ce que je dis dans tous mes livres. Je n’ai pas de temps à perdre avec des choses qui ne donnent pas d’élan à mon enthousiasme. On passe beaucoup de temps à discuter avec l’autre sur son propre terrain, celui du dictateur, du chef ou du pouvoir. Je pense qu’on lui donne beaucoup trop de place, alors qu’on devrait plutôt parler de ce qui nous regarde et nous intéresse.
TP : Dans votre dernier ouvrage, Journal d’un écrivain en pyjama, vous semblez regretter l’importance que semble de plus en plus prendre la figure de l’écrivain (comme personnalité publique), au détriment peut-être de l’œuvre, de la littérature. Est-ce un défi particulier de la littérature contemporaine ? Êtes-vous d’accord avec ceux qui disent que la littérature n’a plus de fonction que spectaculaire, puisque c’est une activité qui se pratique dans l’indifférence généralisée ?
DL : Il est vrai que depuis une quarantaine d’années, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Bien sûr, le fait de l’écrivain célèbre n’est pas nouveau ; déjà, les philosophes grecs l’étaient à leur époque. Je suis sûr que Socrate était une sorte de rock star d’Athènes. Mais ce que je remarque de nouveau, c’est l’intrusion du lecteur, des lecteurs, sur ce terrain. C’est ce qui fait, d’ailleurs, que l’image de rock star devient absolument recevable. L’écrivain, après avoir publié un livre, fait une tournée, va voir les lecteurs. De plus en plus, le cercle s’élargit. Autrefois, ce n’étaient que les écrivains connus – américains, français, allemands… – qui faisaient des choses comme ça. Maintenant, même les écrivains de taille moyenne, c’est-à-dire dont les livres ont une petite diffusion, font des tournées aussi, sont invités dans les festivals, et rencontrent des lecteurs qui font signer les livres qu’ils vont lire. C’est au point où on se demande si les gens lisent les livres qui ne sont pas signés par l’auteur ! J’ai même entendu quelqu’un dire : moi, je ne lis un livre que si j’ai rencontré l’auteur et si je l’aime. Beaucoup d’auteurs ne passent pas ce test peut-être, même s’ils sont meilleurs que ceux qui sont gentils… Ajoutons à cela le fait que de plus en plus, en France et même au Québec, la plupart des villes de taille moyenne ont leur propre festival de littérature qui cherche à inviter des écrivains. Ce n’est certes pas une mauvaise chose pour la diffusion de la littérature, mais je me demande si cela n’aurait pas un impact sur l’écriture elle-même, du fait qu’on rencontre de plus en plus de gens qui nous lisent et nous donnent leur opinion sur ce que nous écrivons. Avant, l’écrivain ne rencontrait presque jamais son lecteur, de sorte que s’établissait une sorte de solitude parallèle entre celui qui est en train d’écrire et celui qui est en train de le lire à l’autre bout de la ville, tous les deux seuls, sans que ces deux êtres ne se croisent. C’est une situation nouvelle où ils se rencontrent et échangent leur point de vue chacun sur l’autre.
TP : Vous avez signé, en 2007, le manifeste Pour une littérature-monde en français, qui remet en question le rapport centre-périphérie entre la France et la francophonie. Depuis, cette expression a été utilisée à toutes les sauces. Pouvez-vous expliquer ce que la « littérature-monde en français » représente exactement pour vous?
DL : Je voulais qu’on précise la question de la francophonie, dans ses rapports à la fois à l’économie et à la culture. Il y avait un besoin, de la part de la France, de rassembler tout ceux qui parlent français sur la planète pour faire le poids à l’anglophonie qui, de plus en plus, s’affirmait comme puissance démographique. La littérature a une grande visibilité, d’autant plus que les écrivains peuvent venir de toutes les classes sociales, contrairement à l’économie, qui ne quantifie que les puissants et les riches. À l’inverse, les écrivains viennent de partout. J’avais compris qu’avec la francophonie, Paris est à part, et le reste est la province, que ce soit la province française ou les autres pays parlant français. Je ne pouvais accepter ce fait d’être un écrivain provincial, parce que j’écris précisément pour sortir de l’espace où je suis, pour aller dans un lieu à la fois intemporel et sans espace. J’écris à partir d’une grande rêverie, je n’écris donc pas pour me faire remettre à ma place après. C’est pour ça que j’étais d’accord avec cette idée d’une « littérature-monde », qui est le contraire de la mondialisation. L’idée est de faire en sorte que la marge devienne le centre ; on prend place au centre et comme centre. Il n’y a plus de francophonie qui ne soit pas la France, c’est-à-dire regroupant tous les pays parlant français sauf la France.
D’ailleurs, l’idée même de classer les écrivains par langue est déjà pour moi une idée assez provinciale. Je ne suis pas un écrivain de langue française, ni francophone, je suis un écrivain. J’écris avec un langage qui ne tient pas forcément compte de ce langage codé avec lequel on m’identifie. Peut-être que si on analyse ce que j’écris, on verra que je suis plus proche des Allemands, des Sud‑Africains, des Scandinaves, des Américains ou des Argentins. On enferme l’écrivain dans la langue dans laquelle il écrit, ce que je trouve assez limité. La bibliothèque de l’écrivain contient beaucoup d’écrivains de partout. Je lis Tolstoï ; je le lis en français, c’est vrai. Je lis Borges ; je le lis en français, c’est vrai. Je lis Günther Grass ; je le lis en français, c’est vrai. C’est ma langue de base, le français. Je lis tous ces écrivains-là, mais je sais que Günther Grass n’est pas Tolstoï, et que Tolstoï n’a pas la sensibilité de Diderot et que Diderot n’est pas Hemingway. Même si je lis Le vieil homme et la mer en français, je sais que c’est un écrivain américain que je suis en train de lire et qu’il n’a rien à voir avec Mauriac, par exemple. C’est pour ça que je me suis dit qu’il est peut-être mieux de dire « littérature‑monde » que de dire littérature francophone.
TP : On peut dire que vous êtes un écrivain de l’espace, et vous vous servez du traitement de l’espace pour, en quelque sorte, compenser l’asymétrie symbolique entre les centres littéraires et les périphéries : « Y a-t-il des sociétés plus littéraires que d’autres? Certaines ont donné de bonnes preuves qui nous font croire à leur aptitude, mais je doute que ce soit dans leur ADN. Il est vrai que Paris, Manhattan et Berlin se sont retrouvés plus souvent dans un livre que Petit-Goâve. Je me suis dit qu’il fallait réparer cette injustice. Le monde ne pouvait vivre plus longtemps sans connaître les gens de Petit-Goâve. » (p. 206) D’autres écrivains caribéens (je pense aux Martiniquais Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant) sont des écrivains de la langue. On pourrait transposer votre question : y a-t-il une langue plus littéraire que d’autres? Est-ce que le créole est trop « social », particularisant ou régional, pour qu’on puisse faire le même traitement à la langue que vous faites à l’espace?
DL : Je pense que personne n’est pris dans sa langue. Sinon, on ne devient pas écrivain. Chaque écrivain doit en quelque sorte en inventer une nouvelle. Par ailleurs, comme romancier on écrit beaucoup plus dans la musique, à l’inverse de l’essai ou du journalisme, qui disent exactement les choses. Je crois que c’est peut-être ça l’erreur, de croire qu’on écrit dans sa langue. Il faut arriver à atteindre la musique. C’est même tout le problème de la traduction, d’arriver à capter cette musique. Les mauvais traducteurs, ce sont les gens qui se réfèrent à la langue de l’écrivain qu’ils ont à traduire, alors que l’écrivain doit d’abord effectuer une rupture avec sa propre langue. Il doit déjà se façonner un langage, alors je ne me situe pas dans le fait de créer une langue encore plus locale en prenant des termes qui définissent la région, qui ont une saveur particulière. Je me méfie de toute saveur particulière. J’essaie plutôt de traduire les émotions et les sentiments.
TP : Est-ce que vous observez davantage de solidarité (ou de parenté) entre les écritures francophones (celles du Sud et celles du Nord), entre les écritures postcoloniales (peu importe la langue) ou entre des écritures « régionales » (comme la Caraïbe, ou l’Afrique, ou l’Amérique en son sens continental)?
DL : En fait, je ne suis pas du tout dans ce genre de regard, cela se voit quand on me lit. Dans mon dernier livre par exemple, je cite les écrivains comme ils me viennent. Je suis dans une grande bibliothèque, avec des livres qui sont les énergies individuelles de gens qui ont mis leurs angoisses, leurs nuits blanches, leurs émotions pour tenter précisément de nous faire voir que nous sommes universels. Alors, je ne sépare pas les histoires personnelles, et je n’établis pas de solidarité automatique entre pauvres.
Je pense qu’on peut trouver des amitiés, des affections un peu partout dans le monde. J’ai vécu sous la dictature Duvalier. Il n’était pas le seul à être dictateur, il était escorté d’un bon cinquième de la population. Je ne pense pas que les gens qui parlent la même langue sont nécessairement plus gentils entre eux. Les familles les plus proches se déchirent. La littérature nous a démontré, dans les romans qui parlent d’héritage, dans les romans du XIXe siècle, qui parlaient de comment il suffit qu’un aïeul meure, chez les pauvres comme chez les riches, pour que les autres membres de la famille se disputent l’héritage. Si la famille ne peut pas constituer une identité, une sorte de cohésion, ce n’est pas la langue qui pourrait le faire, ni même la région. En arrivant au pouvoir, Duvalier avait dit, à peu près, qu’il vaut mieux un dictateur noir qu’un colon blanc. La réalité est qu’on ne veut ni de l’un, ni de l’autre. C’est toujours le même argument que les gens ont pour vous écraser. Ils vous disent qu’ils viennent de chez vous, qu’ils ont vécu ce que vous avez vécu, le genre d’argument « mes meilleurs amis sont des Noirs ». Ils font ça pour qu’on ne les soupçonne pas, mais on connaît bien la haine des semblables.
Cela dit, j’aurais pu aussi dire l’amour des semblables. Je ne fais pas de généralisation, je n’y crois simplement pas. Du moins, pas dans la littérature. Là n’est pas, pour moi, le projet de la littérature. Peut‑être en politique pourrait-on tenter de tels rapprochements, pour avoir un semblant de vie en commun. Mais en littérature, les écrivains tentent de dire « écoutez, je ne sais pas ce qu’on va faire avec cette réflexion, mais nous ne sommes pas si différents que cela ». Je ne crois pas que, parce qu’on parle la même langue, on ait nécessairement des solidarités souterraines.
TP : Est-ce donc plutôt que vous vous reconnaissez une solidarité en littérature et par la littérature, une sorte de bibliothèque universelle, qui transcenderait les espaces et remonterait dans le temps aussi ?
DL : Oui, c’est ça, c’est le don de soi, des angoisses, des nuits blanches, des joies secrètes, dans les fêtes intimes à travers le temps. Tous les écrivains, quels qu’ils soient, de quelque langue ils soient, de quelque époque ils soient, ont donné à notre culture. Quand je pense à Goethe, je ne pense pas que c’est un Allemand ; assurément, il vient d’Allemagne, avec une famille et des voisins, mais ce qu’il a donné et qui est parvenu jusqu’à moi, cette énergie est un don de soi qui fait partie de l’héritage humain. Qu’on vienne de Port-au-Prince, comme Jacques Roumain, ou de Martinique, comme Édouard Glissant, ou de Russie, comme Tchekhov, c’est toujours ce même don de soi qui est très émouvant. Nous donnons si peu, et là brusquement nous avons des gens qui se donnent entièrement. Leur énergie traverse les siècles pour nous rejoindre, nous permettre de passer un bon moment et de voir que nous sommes ni totalement perdus, ni totalement seuls. Nos intimités, nos cœurs sont à la fois différents et semblables. Qu’ils viennent nous dire cela, je pense que ça fait partie d’un héritage humain que je ne suis pas prêt à diviser en petites portions de lieu, de langue, de classe, de race, de quoi que ce soit. Pour une fois que nous avons la possibilité d’avoir un héritage commun!
Interview with Dany Laferrière
Translated from original French by: Alisa Belanger
The Postcolonialist : Our review is interested in artistic production that transcends national boundaries and identities in innovative ways. Your background between Haiti, Montreal and the United States is exemplary in this respect. Authors are often categorized by spaces; thus, you have alternately been described as a Haitian, Quebecois, Exiled, Diasporic, Migrant writer, etc. What do you think of these various labels? Are they useful or do they conceal the essential ?
Dany Laferrière: It’s true that I often need to respond to this question. Sometimes, I ask myself the same thing. But I must admit to having had enough of all of these labels, because they serve no purpose, meaning that they only serve the person who comes up with them, and only for a time. For example, the university has a specific task to carry out and the categorization of authors allows it to encompass them better, like a dead butterfly that is easy to examine. Yet, in reality, literary and political labels easily contaminate each other and blur clear-cut answers; this is often the case, in particular, for Migrant Literatures.
TP: In your works, you frequently evoke the ambiguity of your relationship to Haiti, a relationship abounding with a certain form of guilt, but also, and above all, lightheartedness : “I pass through the world, whistling, leaving behind me an island at drift. Without ever forgetting it, I knew from the beginning that I needed to take a distance from it so that it would not pull me into its spiral. To help someone out of a hole, you can’t fall into it with the person. That’s me, with the twenty-six letters of the alphabet, my only fortune, at the bottom of my pocket.” (Journal d’un écrivain en pyjama, p. 16-17) Is this lightheartedness, or flippancy, representative of your relationship to all of these identities ?
DL: This is a very vast question to which I’ve dedicated several entire books. There are some relatively violent situations in Haiti, which a person feels all the more strongly when living in a rather calm city, like Montreal. But guilt isn’t my style. I remember that after the earthquake [ed.: the earthquake in Haiti occurred on January 12, 2010], my writer friends asked themselves if they shouldn’t feel guilty to be alive when all of these people died. My reasoning went like this: by no means would those who died have wanted us to die with them. No one wishes misfortune on others because they are in misfortune. So, I maintain no relationship of guilt to Haiti.
My relationship with Haiti can seem complex if personal life is mixed with literature. What I say in my books shouldn’t be confused with my reality. My writing casts a wide net, tries to render all kinds of emotions from different people, both Haitians and the exiled. Their experiences contribute to my works. Since I know that there are some people who feel guilty to be outside Haiti, it happens that there are traces of that guilt in my books. I always give the book priority; when I want to think seriously about something, I write a book. It allows me to explore several angles of the question, because life is a kaleidoscope.
TP: Does the literary recognition that you’ve received in Quebec translate into a sense of belonging?
DL: Again, I distinguish between personal life and literature. Of course, I write in Quebec, I publish in Quebec, all of my books have first come out in Quebec editions before coming out elsewhere. However, I consider myself an international writer, without formalities, in the sense that, for me, the promise of literature is universality. I write to understand what I live, and I share my feelings, but, at the same time, to discover that it’s the situation for the all of those who live on this planet. In fact, I’m not alone; that’s it, the promise of literature. You’re not alone. When we scratch beneath the thin folkloric surface of individuals, we realize that human feelings are the same. I’m not trying to describe myself through my literature, I’m trying to write what I feel.
As for this integration into Quebec society, it’s true that I accomplish it in a civic way. I participate in what happens in Quebec, I’m sensitive to the events that happen to us, to the debates that impact us—in sum, daily reality.
TP: You bring together a good part of your work, from your first novel, Comment faire l’amour à un Nègre sans se fatiguer (1985) [How to Make Love to a Negro without Getting Tired (1987)] to Le Cri des oiseaux fous (2000), in what you call your « American autobiography ». Beyond the continental space that is covered in these works, they could be classified as childhood (or memory) narratives and contemporary narratives. Have these various continental spaces changed meaning with the passing of time?
DL: I would like to add a comment: this account of an “American autobiography” in ten volumes is from me. I was fed up with hearing people say that, in my novels, there was, on the one hand, a character with a sensitive heart and sincere affection for his family, who was found in the novels that happen in Haiti, and, on the other hand, a sort of international predator, an urban character open to North American writing, who is found in my novels that happen in North America (notably Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer [How to Make Love to a Negro without Getting Tired] et Cette grenade dans la main du jeune Nègre est-elle une arme ou un fruit ? [Why Must a Black Writer Write About Sex?]. I wanted to bring together these apparently divergent positions, to make my readers understand, and especially the students who analyze my works—by the way, I thank them for it—that it’s all in fact from one person, the same work, the same America, that Port-au-Prince and Petit-Goâve are also cities on this continent. “American autobiography” doesn’t mean the United States, but that continent, a passage through a unique story, like through politics, the economy, racism and all of the elements that define this part of the world. I wanted to say all of that in a simple way, to stop others from cutting up my career work, working separately on the Haitian part and North American part. Thinking that I might not write another book, I said that my ten books formed an “American autobiography”; it was simply a passing strategy at the time. Then, I continued to write, and my books continue to fall into this large pool. I don’t see why Pays sans chapeau (1996) [Down among the Dead Men (1997)] would be part of it and not L’énigme du retour (2009) [The Return (2011)].
Next, analysts, critics and people who study books are of course free in all respects, even to contest what I say. I am not the reference for my books. I give technical precisions, which doesn’t invalidate other analyses. I nonetheless insist on saying to be careful when using words like “memory,” not to make up a personal story. There is no writer who is not a writer of memory. No such thing exists. We cannot write anything other than what lives in us, and what lives in us is first and foremost time that passes. I have the impression that “memory” is reserved for those in exile, as though memory were only tied to space, movement. As though time didn’t exist, space were the only thing to define, to determine memory, whereas a person can stay in the same city, the same neighborhood, the same house and have a memory of time passing, and nostalgia for the time that cannot be grasped. We write with so many things.
TP: In Le cri des oiseaux fous, your narrator makes a distinction between political and cultural engagement. Its action takes place principally in the sector of culture, through the affirmation of independent spirit as a form of resistance to power—doubtless the best possible resistance, since, precisely, it takes no interest in power. Could you elaborate on this position?
DL: This is the case in a dictatorship. In the completely capitalist cities of North America, it’s the group that is a form of resistance, instead. As for the dictator, he stole collective meaning, took it hostage and, naturally, wants others to submit to him one after the other. There are few things as able to oppress individuals as effectively as fear. Fear is an individual thing. The dream of the dictator is to instill, into each individual, this fear. In this context, we should therefore not lose sight of the fact that the most resistant is still the individual. What the dictator wants to do is reduce us to nothing, humiliate us and make us lose all individuality. That’s why there are many points that are associated with personal humiliation, whether under colonization or a dictatorship. They want to humiliate you. In more industrialized countries, they simply want to steal your energy, not necessarily humiliate you individually. They want to reduce you to suicide, whereas institutions want to sap your energy to convert it into money, power. They don’t seek to humiliate you: your position is already humiliating to be in this group forced to work under difficult conditions. But in dictatorships, since no work is offered, there is no working class. Individuals must be taken one by one. That’s what resistance is, the individual is the first defense. If you allow yourself to be inhabited by the fear that the dictator wants to implant in you, there is no chance of resistance.
TP: Can literature have a similar function in nations that belong to the global « North » and « South » ? How can the functions and concerns of literature in Haiti and Quebec come together?
DL: As for me, I remain immersed in the object itself, literature. When you spend most of your time hammering out adjectives or adverbs, you don’t have much time to view issues from that angle. It’s up to universities to reflect on what is similar and different. Of course, there is a universal aspect to literature. The feelings, emotions, individual resistance that we have seen since Antigone by Sophocles.
When Antigone says: “I was born to join in love, not hate,” it’s a bit what I say in all of my books. I don’t have the time to waste on things that don’t give momentum to my enthusiasm. We spend a lot of time talking with the Other on his own terrain, that of the dictator, the leader or power. I think that we give him too much space, whereas we should speak instead about what concerns us and interests us.
TP: In your last work, Journal d’un écrivain en pyjama, you seem to regret the importance increasingly given to the writer as a figurehead (or public personality), perhaps to the detriment of the work, of literature. Is this a challenge specific to contemporary literature? Do you agree with those who say that literature merely serves the function of an onlooker, since it’s an activity practiced amid generalized indifference?
DL: It’s true that for the past forty years, there has been something new happening. Of course, the famous writer is not new; already, Greek philosophers were famous in their era. I am sure that Socrates was a sort of rock star in Athens. But what I notice that’s new is the intrusion of the reader in the landscape. Moreover, that’s what makes the image of the rock star completely permissible. The writer, after having published a book, goes on tour, goes to see the readers. More and more, the circle is widening. In the past, it was only well-known writers—American, French, German…. – who did those types of things. Now, even mid-range writers, meaning those whose books have a small distribution, go on tour, too; they’re invited to festivals; and, they meet readers who have books signed that they’re going to read. It’s to the point where you wonder if people read books that aren’t signed by the author. I even heard someone say: me, I don’t read a book unless I’ve met and I like the author. A lot of authors perhaps don’t pass this test, even if they’re better than those who are nice… Let’s add to this the fact that, more and more, in France and even in Quebec, the majority of mid-sized cities have their own literary festival which seeks to invite writers. This is certainly not a bad idea for the distribution of literature, but I wonder if it doesn’t have an impact on the writing itself, based on the fact that we are meeting more and more of those who read us and who give us their opinion on what we write. Before, the writer almost never met his reader, such that a sort of parallel solitude was established between the one who is writing and the one who is reading on the other end of town, both alone, without running into each other. This is a new situation where they meet and exchange their viewpoint on each other.
TP: In 2007, you signed the manifesto Pour une littérature-monde en français, which draws into question the center-periphery relationship between France and la Francophonie. Since then, this expression has been used far and wide. Can you explain exactly what “World Literature in French” represents for you?
DL: I would like us to be specific on the question of la Francophonie, in its ties to both the economy and culture. There was a need, on behalf of France, to bring together all of those who speak French on the planet in order to carry weight against the English-speaking world [anglophonie] which was affirming itself more and more as a demographic powerhouse. Literature has great visibility, all the more so that writers can come from all social classes, unlike the economy, which only quantifies the powerful and the rich. Inversely, writers come from everywhere. I had understood that with la Francophonie, Paris is a place unto itself, and the rest is provincial, whether the French provinces or other countries that speak French. I could not accept the idea of being a provincial writer, because I write precisely in order to leave the space where I am, to go to a point that is both atemporal and placeless. I write from a great daydream; hence, I don’t write in order to be put back in my place afterwards. That’s why I agreed with this idea of a “World Literature,” which is the opposite of globalization. The idea is to make it so the margins become the center; we take our place in the center and as a center. There is no longer a Francophonie that is not France, meaning that brings together all of the French-speaking countries except France.
Moreover, the idea itself of classifying writers by language is already for me a rather provincial idea. I’m not a French-language, nor a Francophone writer, I am a writer. I write with a language that doesn’t necessarily take into account this coded language with which I’m identified. Perhaps if others analyze what I write, they will see that I am closer to Germans, South Africans, Scandinavians, Americans or Argentineans. They imprison the writer in the language with which he writes, which I find rather limiting. The writer’s library contains a lot of writers from everywhere. I read Tolstoy; I read him in French, it’s true. I read Borges; I read him in French, it’s true. I read Günther Grass; I read him in French, it’s true. French is my foundational language. I read all of those writers, but I know that Günther Grass isn’t Tolstoy, and that Tolstoy doesn’t have the sensibility of Diderot and that Diderot isn’t Hemingway. Even if I read The Old Man and the Sea in French, I know that it’s an American writer that I am reading and that he has nothing to do with Mauriac, for example. That’s why I said to myself that it’s perhaps better to say “World Literature” than to say Francophone literature.
TP: It could be said that you are a writer of space, and you use the treatment of space in order to compensate, in a way, for the asymmetries between literary centers and peripheries: “Are there some societies more literary than others? Certain ones gave good evidence that make us believe in their aptitude, but I doubt that it’s in their DNA. It’s true that Paris, Manhattan and Berlin are more often found in a book than Petit-Goâve. I told myself that this injustice needed to be redeemed. The world could no longer live for much time without knowing the people of Petit-Goâve.” (p. 206) Other Caribbean writers (I’m thinking of Patrick Chamoiseau and Raphaël Confiant from Martinique) are writers of language. Your question could be transposed: “Is there a language that is more literary than others? Is Creole too « social », making the regional too specific, for a writer to treat a language in the same way that you treat space?
DL: I think that no one is prisoner to his language. Otherwise, a person doesn’t become a writer. Each writer must invent a new one, in a way. Also, as a novelist, a person writes much more inside music, unlike essays or journalism, which say things precisely. That may be it, I believe, the error: to believe that we write in our language. We have to manage to reach music. That’s the entire problem of translation, too, managing to capture that music. Bad translators, they’re the ones who refer to the language of the writer that they have to translate, whereas the writer must first effectuate a break with his own language. He already has to devise a language for himself, so I don’t relate to the notion of creating an even more local language by using terms that define the region, that have a particular savor to them. I am weary of any particular savor. I try instead to translate emotions and feelings.
TP: Do you observe more solidarity (or affiliation) between Francophone writings (those of the South and the North), between postcolonial writings (in any language) or between “regional” writings (like the Caribbean, or Africa, or America, as a continent)?
DL: Actually, I don’t look at it in this way at all, as people can see when they read me. In my last book, for example, I cite writers as they come to me. I’m in a vast library, with books that are the individual energy of people who have expressed their anxieties, their sleepless nights, their emotions precisely to try to make us see that we are universal. Therefore, I don’t separate personal stories, and I don’t establish an automatic solidarity between the poor.
I think that we can find friendships, affections almost anywhere in the world. I lived under the Duvalier dictatorship. He wasn’t the only one to be a dictator, he was attended to by a good fifth of the population. I don’t think that people who speak the same language are necessarily nicer among themselves. The closest families tear themselves apart. Literature has demonstrated to us, in the novels that speak of inheritance, in the novels of the 19th century, that spoke of how it was enough that an ancestor die, among the poor as well as among the rich, for the other members of the family to fight over the inheritance. If the family cannot forge an identity, a sort of cohesion, then it’s not the language that might do so, nor even the region. When he arrived in power, Duvalier said, more or less, that it was better to have a black dictator than a white colonizer. The reality is that we want neither one nor the other. People always have the same argument to crush you. They tell you that they come from the same place as you, that they’ve lived what you’ve lived, the kind of argument “my best friends are Blacks.” They do it so that they aren’t suspected, but we really know the hate of kin.
That said, I also could have said the love of kin. I don’t generalize, I simply don’t believe in it. At least, not in literature. That’s not, for me, the goal of literature. Maybe in politics they could try those kinds of comparisons, to have an appearance of shared experience. But in literature, writers try to say “listen, I don’t know what anyone will do with these thoughts, but we’re not so different as all that.” I don’t think that, because we speak the same language, we necessarily have underground solidarities.
TP: Do you prefer to distinguish a solidarity in and through literature, a sort of universal library, which may go beyond spaces and turn back time, as well?
DL : Yes, that’s it, it’s the gift of the self, the anxieties, the fitful nights, the secret joys in the private celebrations across time. All writers, whomever they may be, in whatever language they write, in whatever era, have given to our culture. When I think about Goethe, I don’t think that he’s a German; of course, he comes from Germany, with a family and neighbors, but what he gave and what has been passed down to me, this energy, is a gift of the self that belongs to the heritage of humanity. Whether a writer comes from Port-au-Prince, like Jacques Roumain, or from Martinique, like Edouard Glissant, or from Russia, like Tchekhov, it always remains this same gift of the self which is very moving. We give so little, and, there, suddenly, we have people who give themselves entirely. Their energy endures across the centuries to meet us, allow us to have a good time and to see that we’re not totally lost, nor totally alone. Our private thoughts, our hearts are both different and akin. That they come to us to tell us so, I think that it’s part of a human heritage that I am not ready to divide in little segments by location, language, class, race, or whatever else. Not when we have the chance for once to have a common heritage!