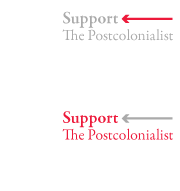En analysant des œuvres littéraires coloniales, Elleke Boehmer indique qu’au début du XIXe siècle, l’impérialisme britannique s’est identifié à Robinson Crusoë sur l’île sauvage qu’il s’efforçait de civiliser. Correspondant à la volonté de l’expansionnisme, le héros de Defoë symbolise le courage national désireux de construire du nouveau sur les ruines du passé chaotique. Les colonisateurs se présentaient comme les conquérants héroïques du vaste monde, les ambassadeurs de la civilisation auprès des peuples qui en étaient dépourvus. Cette ambition n’est pas l’apanage de l’Europe et taraude également la Chine[1], malgré les dénégations du gouvernement chinois actuel. La littérature coloniale chinoise au Tibet est née pour servir l’installation de la colonisation chinoise au Tibet. C’est une littérature d’actualité politique pour lecteurs chinois. Elle se compose de deux types d’auteurs, militaires et intellectuels, et l’on distingue deux périodes, celle des années cinquante aux années soixante-dix puis celle qui mène à la fin du siècle dernier. La littérature coloniale chinoise au Tibet non seulement témoigne des évènements historiques de ces deux époques, mais aussi entretient chez les colons chinois un sentiment de fierté identitaire, celui d’appartenir à la grande nation chinoise contemporaine. Elle a donc joué un rôle important auprès du pouvoir chinois dans sa conquête du Nouveau Monde tibétain.
Après son succès à Beijing, Mao Zedong a vu dans le Tibet une région stratégique pour la Chine à la fois sur le plan politique et économique. En 1950, il a donné l’ordre à l’armée de la libération populaire d’« entrer par la force militaire au Tibet进军西藏 ». A la différence des explorateurs européens du continent africain ou des conquistadors de l’Amérique latine, les masses de colons chinois pénétrèrent sur le territoire tibétain dans un but politique précis: intégrer le Tibet au sein de la grande famille chinoise ; tel était le pari de Mao Zedong.
Le pays de neige apparaît très lointain et mystérieux dans la présentation historique qu’en donnent les Chinois. Le mariage de deux princesses chinoises avec des princes tibétains en 640 et en 710 a donné naissance à un légender[2] empreint de mélancolie et de tristesse. On y cite les noms des montagnes et des rivières croisées par les deux héroïnes chinoises sur la route du mariage, soulignant ainsi la longue distance semée d’embûches qui sépare la Chine du Tibet. Pays fort grand[3] et difficile d’accès, le Tibet a très justement été baptisé le « toit du monde »[4]. Comme l’écrit le géographe chinois Xu Huaxin, la peur n’épargne personne dans cette géographie, car les oiseaux eux-mêmes ne peuvent en volant traverser les montagnes[5]. En réalité, avant 1950, le peuple chinois manque de véritables connaissances sur le Tibet, ainsi que sur l’Histoire de la relation entre la Chine et le Tibet. Ce n’est qu’à partir de 1950 que le peuple chinois commence à croire, à cause de la propagande gouvernementale, qu’il faudrait faire évoluer le système politique tibétain, que le Tibet constituerait une partie sous-développée de la Chine, et, que le peuple chinois exercerait sur les Tibétains misérables un pouvoir libérateur.
Afin de réaliser son projet d’immigration chinoise au Tibet, Mao Zedong fit construire deux routes menant au Tibet: l’une partant de la province chinoise du Sichuan au sud-ouest de la Chine, l’autre du nord-ouest. Un seul ordre : surmonter toutes les difficultés, quel que soit le risque physique ou matériel. Durant quatre années, des milliers de soldats et de techniciens chinois, ainsi que les prisonniers de guerre, qui ne sont pas habitués à vivre en haute altitude, mais aussi des paysans tibétains s’attellent sans relâche à une tâche titanesque : 430 ponts sont construits, 3781 tunnels percés et ouverts dans 14 montagnes au-dessus de 4000 mètres. Enfin, en 1954, une route de 2416 kilomètres de long relie la province du Sichuan au Tibet, tandis que, parallèlement, 2122 kilomètres carrossables conduisent désormais de la province du Qinghai à Lhassa. Selon les ouï-dire, chaque kilomètre de route avait été tracé au prix d’une vie humaine[6]. Dès lors, le Tibet entre dans une période de son histoire « particulièrement sombre »[7].
Face à ces obstacles géographiques, Mao Zedong avait besoin de convaincre le peuple chinois du bien-fondé du projet colonisateur afin d’obtenir le soutien moral et matériel nécessaire à la conquête du monde tibétain. Alors que des milliers de soldats chinois sacrifiaient chaque jour leur vie à son ambition, l’encouragement psychologique était d’une nécessité capitale. La propagande avait donc pour tâche d’éduquer le peuple sur le Tibet et d’inciter son héroïsme révolutionnaire. .
Entrée et installation dans le Monde tibétain
I. L’apologie de l’héroïsme révolutionnaire en poésie
L’héroïsme est la caution par excellence de la colonisation. Mais l’héroïsme loué par la littérature chinoise coloniale au Tibet au début des années cinquante du siècle dernier n’est pas celui de Daniel Defoë ou de Joseph Conrad. C’est avant tout un outil de propagande pour asseoir une autorité et un moyen de cultiver massivement le sentiment identitaire sous le sceau de la Révolution. Le PCC (Parti Communiste Chinois) au pouvoir avait besoin de convaincre le peuple chinois qu’il s’engageait dans une bataille plus ardue encore que la Longue Marche, la Guerre sino-japonaise ou le combat contre le Guomindang (l’ennemi de Mao), une bataille plus difficile encore que la guerre de la Corée du Nord contre les Américains. La mort de milliers de soldats et la destruction d’une civilisation avec laquelle, depuis des siècles, la Chine avait rarement entretenu des relations de voisinage ne pouvaient se justifier que par l’idéal politique, lequel venait d’ailleurs de permettre au PCC d’unifier la Chine tout entière. L’héroïsme révolutionnaire était d’ailleurs mobilisé pour la première fois durant la Longue Marche, entre octobre 1934 et octobre 1935, sous le commandement de Mao Zedong, lorsque les trente mille soldats de l’Armée rouge traversaient à pied les vingt-cinq mille kilomètres des onze régions chinoises, endurant d’innombrables épreuves afin d’échapper à l’ennemi lancé à leur poursuite. Le Grand Timonier composa alors de nombreux poèmes qui exaltaient le courage des soldats et les incitaient à franchir les obstacles les plus insurmontables. Toute l’adresse du poète consistait à métamorphoser sur un mode romantique les difficultés rencontrées : les hautes chaînes montagneuses se transformaient en fines vaguelettes de la rivière, les pics élevés devenaient de petites mottes de terre[8]. Le masque des métaphores venait à bout de tous les dangers et cette culture de fanatisme idéologique devint une arme puissante pour faire avancer l’armée en marche vers le Tibet. Le PCC tira gloire de cette réussite à peu de frais : « manger du millet et tirer avec le vieux fusil » suffisait « pour conquérir le Monde »[9]. L’héroïsme révolutionnaire à lui seul renversait les montagnes et menait le soldat jusqu’à l’oubli de sa souffrance sous les ordres de Mao Zedong.
L’héroïsme révolutionnaire chinois fait éclore des poèmes de forme libre ayant recours à la langue du peuple. Ils constituent à eux seuls l’essentiel de la littérature chinoise des débuts de la Chine communiste à partir de 1949 : ce sont des outils de propagande idéologique qui faisaient l’éloge de Mao Zedong et du PCC, un critère esthétique et édifiant au service de l’éducation du peuple de la Nouvelle Chine : que chaque lecteur soit fier de vivre sous le nouveau régime[10]. Lors de l’entrée au Tibet, ce type de poème sert également de support médiatique ; d’une part, il encourage l’héroïsme des soldats, d’autre part, il influence l’ensemble de la population chinoise dont il sollicite la confiance et le soutien. C’est pourquoi le poème du jeune officier Gao Ping a été diffusé dans toute la nation dès sa première publication en 1952. « Percer la Montagne de moineau » devint l’un des poèmes les plus cités dans le pays et fait partie des plus connus dans le répertoire contemporain du PCC. Après sa première édition à Beijing dans le numéro 5 de a revue littéraire L’art de l’armée de la libération [11], organe du PCC, ce poème a été immédiatement rediffusé dans de nombreuses autres revues, puis transformé en chanson populaire. C’est l’emblème glorieux de l’héroïsme des Chinois lancés à la conquête du Nouveau Monde tibétain.
Gao Ping n’avait que vingt ans lorsqu’il participa à la construction de la route vers le Tibet. Inspirées par l’héroïsme révolutionnaire, les trente-deux strophes de son poème en vers libres proposent l’image d’un Tibet qui refuse de se laisser pénétrer, telle cette « montagne du Moineau/ depuis des lustres inhabitable/ dont les oiseaux mêmes ne peuvent atteindre le sommet», car « Il neige sans cesse des années durant/ le sol gèle jusqu’à trois mètres de profondeur/ les rochers se mettent en travers du chemin ». Ainsi, les lecteurs chinois découvrent l’hostilité d’une nature avec laquelle leurs soldats doivent quotidiennement composer. Le poète réussit à communiquer la force héroïque des soldats au service de la Révolution et à faire partager leur détermination à conquérir non seulement le Tibet, mais aussi la nature elle-même. Car la réalité de la colonisation commence par l’aventure périlleuse d’une route qui dompte le paysage en le faisant plier sous la volonté de l’homme : « Construire la route de Chine au Tibet/ c’est une étape-clé/ l’armée de libération populaire/ veut absolument trouer la montagne/ la montagne du Moineau est très haute / moins haute que notre esprit/ les pierres sont très dures / moins dures que notre volonté »[12].
Les autorités encouragent la composition de tels poèmes écrits à la gloire des héros de la conquête du Tibet. Yang Xinghuo est une jeune diplômée en chimie ; à vingt-six ans, elle abandonne ses activités scientifiques pour se consacrer au panégyrique de la sinisation du Tibet. Bientôt une poète militaire célèbre en Chine, elle est toute dévouée à la propagande colonisatrice, et ses strophes brillent comme des enseignes idéologiques : « grimpe n’importe quelle montagne/ tu es soutenu par l’esprit du parti/ traverse n’importe quelle rivière/ n’est-ce pas? » Yang Xoinghuo exploita toutes les formes littéraires pour servir la sinisation du Tibet : elle publia aussi des nouvelles, des ouvrages en prose, une pièce d’opéra et un scénario, et elle composa des paroles de chansons. La Chine, le PCC, l’idéologie, la fierté de parti, la patrie, la nation et le haut plateau sont autant de leitmotivs récurrents d’une œuvre à l’autre. Yang Xinghuo exalte la fierté collective d’être le maître d’un pays occupé où la terre est désormais apprivoisée : « la rue de Lhassa couverte de goudron/ L’avenue de lumière/ j’y marche/ écarte mes bras/ si fière ! / La rue de Lhassa couverte de goudron/ L’avenue de lumière / j’y marche/ songe au temps de l’entrée au Tibet/ le petit sentier caché dans la tempête de neige ! ».
Ce n’est d’ailleurs pas une coïncidence si le « je» lyrique chez Yang Xoinghuo ressemble au promeneur solitaire de la poésie romantique, bien qu’il exprime également la nostalgie et la distanciation typiques plutôt de l’époque victorienne. Selon Erik Erikson, l’identité se conçoit chez l’individu comme un sentiment d’harmonie, le « sentiment subjectif et tonique d’une unité personnelle et d’une continuité temporelle » au sein de la société. Il est d’abord et avant tout question d’inspirer le sentiment héroïque de l’identité chinoise révolutionnaire. En effet, les analyses nuancées d’Elleke Boehmer révèlent les similitudes entre l’époque de conquête chinoise du Tibet et la période victorienne en Angleterre, quand, à la fin du dix-neuvième siècle, le peuple britannique, s’intéressant davantage aux conquêtes territoriales de l’impérialisme anglais, avait soif de partager la gloire des colons. La poésie, la chanson et toutes les formes de jeux linguistiques qui portent les rêves de l’impérialisme[13] se mettent alors à satisfaire le besoin d’admirer les héros au sens fort du terme. À l’époque où les Chinois cherchaient à entrer au Tibet, que les médias chinois nomment la période de « l’avancement forcé »,[14] un service collectait les comptines composées par les soldats sur le lieu du chantier, puis les diffusait pour fabriquer de nouveaux héros, les jeunes Chinois recrutés au bord de la route menant au Tibet. La poésie occupe une place de choix dans la littérature chinoise à cette époque où l’on assiste à l’efflorescence de tout un corpus propagandiste[15].
2) L’implantation douloureuse en terre tibétaine dans le récit
Viser la campagne pour révolutionner le pays était également la stratégie militaire de Mao Zedong pour conquérir la Chine à dominante paysanne. D’une part, la majorité de la population se trouve à la campagne ; d’autre part, c’est la terre qui fournit les ressources de survie. Dès leur installation sur place, les soldats chinois avaient comme objectif une « mission civilisatrice » qui consistait non seulement d’un devoir militaire, mais aussi d’un devoir agricole, celui de faire exploiter les terres cultivables par les paysans tibétains. A partir du moment où s’entame cette nouvelle étape de sinisation, la forme poétique attire moins l’inspiration des colons.
Sous l’égide de Beijing, la littérature coloniale changea d’objectif : l’éloge de l’héroïsme révolutionnaire est remplacé par la volonté de défaire le système politique ancestral par la transformation de la mentalité des Tibétains à l’intérieur du pays. La forme poétique, qui est, de par sa nature même, lyrique ou épique, s’avéra être peu adaptée à l’argumentation que requiert un tel objectif. Le roman du pouvoir et le roman du devoir y suppléeront. Très tôt, les colons chinois empruntent l’écriture romanesque réaliste qui est caractéristique des littératures coloniales. Jean-Marie Seillan distingue globalement quatre sortes de roman dans la littérature coloniale[16] que l’on retrouve également dans la littérature coloniale chinoise: le roman du pouvoir, le roman du devoir, le roman du savoir et le roman de l’avoir. Apparaissent surtout chez les écrivains colons de la première génération ces deux premières catégories où il est question de s’imposer et de s’enraciner en territoire tibétain.
Le premier roman colonial chinois au Tibet s’intitule Nous semons l’amour[17]. Ecrit par un officier de vingt-six ans au Tibet, Xu Huaizhong, la fiction traite de l’actualité vécue par les colons chinois qui s’y implantent. Unissant trois protagonistes, tous des colons chinois, l’intrigue amoureuse se déroule dans un service du développement technologique agricole à la campagne tibétaine. L’introduction dans le récit du représentant du PCC local, un personnage important, a lieu le 1er octobre, date de la commémoration de la naissance de la République Populaire de Chine décrétée par Mao Zedong en 1949. Lors de ce jour de fête nationale, le représentant du PCC, qui est le directeur chinois du district nommé par le gouvernement à Beijing, inaugure auprès des paysans l’usage d’outils chinois pour labourer la terre. La démonstration symbolise bien sûr la prise de possession de la terre tibétaine, en même temps qu’elle signale la construction d’une nouvelle puissance politique chinoise. De sa propre main, le représentant du PCC sème des graines sur un lot de terre vierge. Planter des graines chinoises dans la terre tibétaine, utiliser les outils chinois sur la terre tibétaine, cela signifie l’implantation dans le pays au sens propre comme au sens figuré.
Le premier amour semé dans le roman est celui que le directeur chinois, qui incarne l’ordre politique du PCC, porte à sa fille ainsi qu’à tous les habitants de son district, à l’égard de qui il fait preuve d’une attachement paternaliste. Notamment, il demande à sa fille de travailler d’abord comme observatrice de météo, puis comme infirmière et, enfin, comme institutrice dans une école pour enseigner le chinois aux enfants tibétains. Aussi met-il son amour paternel au service de la sinisation du Tibet. Le second amour semé dans le roman est celui éprouvé par une spécialiste chinoise du pâturage, dont l’objectif est de changer radicalement le mode d’alpage tibétain. Se prenant pour la maîtresse des lieux, la Chinoise demande aux bergers de quitter leur vie nomade pour se sédentariser dans le bourg. Face à ce personnage de jeune intellectuelle chinoise, l’auteur crée la figure du nouveau travailleur en campant dans le service Lei, un jeune technicien chinois. Malgré qu’il n’ait pas étudié à l’université, celui-ci s’applique à la recherche d’une nouvelle sorte de blé convenable à la géographie du Tibet, et ses découvertes permettront d’obtenir une belle récolte. L’amour de l’intellectuelle et celui du technicien se conjuguent donc pour faciliter simultanément le contrôle des habitants et la culture de la terre.
Voilà trois personnalités, trois sortes d’amour soi-disant bienfaiteur, formant les trois composants que la grande nation chinoise apporte à la nouvelle société coloniale du Tibet. Le référent colonial, qu’il se rapporte à une expérience directe de l’auteur ou à celle de ses lecteurs, fait appel à une mythologie–au sens barthien du terme–des revendications essentialistes, greffée sur une idéologie selon laquelle un peuple supérieur en intelligence et en innovation saurait réinventer une culture déjà vieille de plusieurs siècles[18]. La réussite de la fabrication du mythe politique consiste à conquérir la confiance des lecteurs chinois qui croient désormais en la force de la pensée de Mao.
En dénonçant la cupidité et la cruauté des colonisateurs, Elleke Boehmer indique qu’au début de l’installation coloniale, la véritable nature de cette entreprise politique et économique se cachait derrière des actions de charité auprès des indigènes[19]. De même, au Tibet, le PCC s’érigea en sauveur du peuple autochtone: pour cela, il substitua à la notion traditionnelle de la souffrance, sa propre conception idéologique de l’héroïsme. En 1956, pénétrant les campagnes tibétaines par la force militaire, les Chinois entreprennent une réforme agraire de grande ampleur, qui sape les fondements de la société tibétaine traditionnelle. Historiquement, ce n’était pas la première fois qu’une armée étrangère arrive sur le territoire tibétain, mais aucune n’avait jamais pu y demeurer. Parvenue enfin à Lhassa après avoir sacrifié des milliers de vies chinoises, l’armée du PCC ne voulait pas revivre l’expérience de ses précurseurs. La possession prolongée du Tibet nécessitait encore une nouvelle forme d’héroïsme pour s’y implanter durablement.
En créant dans ses nouvelles galeries de jeunes Tibétaines révolutionnaires, très jolies, mais très pauvres, l’officier chinois Liu Ke[20] s’apitoie sur le destin des paysannes. Selon la vision qu’en donne le PCC, ces femmes—, soit abandonnées par leur mari, soit violées par les riches propriétaires—, souffrent de conditions de vie provoquées par le système colonial sans avoir conscience de l’origine de leurs malheurs. Elles s’y résignent parce que la religion tibétaine traditionnelle enseigne aux croyants que la vie n’est que souffrance. Sous la plume de Liu Ke, des Tibétaines prennent en main leur destin en devenant membres du PCC. Grâce aux bons soins des communistes chinois, certains protagonistes féminins choisissent d’émigrer vers une ville chinoise, promesse d’une vie meilleure. Prenons le cas de Yang Jin : au début, c’est une fillette joueuse et pleine de vivacité. Soudain, à l’âge de cinq ans, Yang Jin perd son père qui part en abandonnant sa famille, qu’il laisse désormais sans nouvelles. La mère, belle et fragile, est obligée de travailler pour survivre. Violée par un riche méchant, elle meurt et l’orpheline devient une esclave. Mais habitée par l’espoir de retrouver son père, Yang Jin demande aux Chinois de l’aider. En contrepoint de cette intrigue, la description du visage de l’héroïne est lourde de sens. D’abord sale et laid, il devient progressivement beau et radieux au fur et à mesure que Yang Lin échappe à sa triste condition. Enfin, métamorphosée par la joie, l’héroïne part étudier en Chine puis revient au Tibet comme fonctionnaire : son visage rayonne alors de bonheur.
Le cruel processus dont les protagonistes féminins de Liu Ke sont victimes se déroule sur le même arrière-plan politique que celui où se trouvent les Tibétaines de Yang Jin. Les critiques littéraires à la solde du PCC approuvent : « nous sommes contents de voir que le peuple tibétain peut désormais vivre heureux dans la nouvelle Chine » affirma l’un de ses dirigeants en 1962[21]. Il s’agit sans doute aucun de récits au service du pouvoir et du devoir.
Le passage de l’identité héroïque à l’identité personnelle souffrante
Dans les années soixante-dix, trois paysages littéraires coexistent au Tibet : la littérature tibétaine d’expression chinoise de la première génération, celle de la seconde génération en pleine éclosion et la littérature coloniale chinoise. Ces trois littératures manifestent chacune un vif intérêt à décrire la complexité du monde tibétain. Dans un climat de liberté d’expression relative, ces trois visages de la littérature s’influencent et s’attachent à satisfaire la curiosité des lecteurs, principalement des Chinois. Cependant, c’est la littérature chinoise coloniale qui a la prééminence. A la fin du XXe siècle, elle regroupe deux catégories d’auteurs dont la première comprend d’anciens colons arrivés au Tibet au début de la colonisation ; ayant participé à la destruction de l’ancien Tibet, ils sont profondément attachés au Nouveau Monde qu’ils construisent. La deuxième catégorie se constitue par contre de la deuxième génération des écrivains colons chinois, majoritairement de jeunes diplômés de l’université. Contrairement à leurs aînés, ils sont plus sensibles à la liberté de penser et de vivre. Ils sont attirés par les paysages et le mode de vie au Tibet. L’usage qu’ils font de la première personne du singulier favorise l’expression de sentiments individuels. Ils ont plus de difficulté dans le contact avec les Tibétains, car ils ne sont pas comme leur aînés les constructeurs du Tibet sinisé, mais plutôt des consommateurs du travail accompli, il leur manque le sentiment de sacrifice et ils ne partagent pas le traumatisme de voir des milliers de morts sur la route entre la Chine et le Tibet.
1) L’expression du mal-être personnel
Les colons chinois de la seconde génération vivent une période de changement. La disparition de Mao en 1976 a été décisive pour la renaissance de la littérature chinoise[22]. Parallèlement, la Chine est de plus en plus traversée par divers courants de pensée occidentale ; ceux-ci sillonnent davantage les œuvres littéraires qui sont autant de sources de réflexion et d’inspiration pour les Chinois. En découvrant le Tibet, beaucoup se rendent compte que la réalité ne correspond pas aux informations officielles. Loin de la modernisation, les conditions de travail et d’existence sont rudes. Cependant, avec l’appui du gouvernement colonial local, ces représentants d’une autre culture extérieure[23] fondent la deuxième génération de la littérature coloniale au Tibet. Elle choisit d’exprimer les sentiments personnels et là réside sa grande différence avec la génération précédente. C’est alors la déception qui domine, le sentiment d’exil, la pénibilité de la vie quotidienne, la difficulté de s’acclimater à ce pays de haute altitude… la souffrance individuelle devient ainsi le thème majeur traité par cette deuxième génération de colons. Le « je » colonisateur est en effet accablé de mélancolie, de tristesse et d’angoisse.
Alors qu’à la même époque, la littérature en Chine dénonce les souffrances vécues durant la Révolution culturelle, les auteurs colons au Tibet privilégient le poème lyrique jusqu’à la fin des années quatre-vingt. En 1983, la revue officielle Littérature tibétaine en chinois crée la rubrique « Poème de la Neige sauvage » pour publier un grand nombre de leurs productions.
A l’instar de la génération précédente, les nouveaux poètes suivent les ordres du Parti si l’on en croit la force d’autorité qui émane de cette métaphore solaire[24]:
- Le soleil dit: je t’appelle
- Ta première réponse est sans motivation
- Quand tu entends le mot(Tibet), la force revient
- Le soleil t’encourage
- tu peux devenir un très bon coureur
- Le soleil te dit : tu peux être un très bon acteur et un très bon cheval
- Le soleil te dit, va de l’avant.
Malgré le contexte politique et la diversité des régions dont ils sont originaires, les poètes souffrent unanimement du mal du pays, et s’interrogent sur la réalité d’une sinisation efficace car, au bout de trente ans de présence chinoise, le Tibet ne s’est guère modernisé. Alors, le poète Zang Qing exprime avec désespoir son aspiration à la vie moderne: « Mon cœur ne veut plus continuer ce vieux rêve trouble/ Je veux être un sifflet éclatant et faire de mon cœur un pont reliant le passé et l’avenir »[25].
Le poète reconnaît que la ténacité de la vie tibétaine quotidienne le séduit. Cependant, l’attrait est moins fort que l’espoir d’atteindre les objectifs communistes, puisque « De l’autre côté de la montagne enneigée, se construit déjà un monde merveilleux qui fait rêver et amasser du bonheur »[26]. Séduit par ce monde, le poète demande au crépuscule de faire s’envoler les bergers vers la mère patrie: « Sorti de la mémoire chagrine, l’espoir s’envole d’un battement d’ailes »[27].
Les souffrances endurées quotidiennement par les Tibétains mettent Zang Qing particulièrement mal à l’aise. Même s’il soutient le PCC au pouvoir au Tibet depuis 1951, il appelle à une amélioration plus nette des conditions de vie du peuple tibétain. Bien que Zang Qing demeure, dans le fond, l’un de ces jeunes diplômés chinois ne sachant pas réaliser le socialisme dans les campagnes tibétaines, il déplore cette situation dans le recueil intitulé La rivière noire[28]. Selon la critique de Liu Zhihua[29], cette série de poèmes est représentative de l’angoisse de toute sa génération. Dans ses soupirs exprimés sous forme interrogative, le poète montre qu’il est enfermé dans une spirale sans issue : le mythe que les Chinois ont tenté de créer au Tibet n’est plus crédible ; il faut édifier un nouveau mythe, souhait intense mais peut-être vain. En mettant l’accent sur le passé du Tibet, Zang Qing donne l’impression de plonger son âme dans les errances de l’isolement.
Nombreux sont les auteurs chinois qui, comme Zang Qing, souffrent de se perdre dans la steppe[30]. La couleur noire évoqué dans le titre de ce recueil rappelle un passé lourd d’obscurantisme. Dans le présent, aussi, malgré les multiples couleurs des drapeaux de prière, le progrès n’apparaît pas. Dans les cinq parties du recueil, intitulées la légende, la géographie, la sensation, la vallée et le lyrisme, certaines strophes se présentent comme des flammes brûlantes. Le poète n’a pas le droit de reculer dans son engagement politique, mais la poésie met du baume à son amertume, elle se présente comme étant l’unique moyen de se consoler. C’est pourquoi, dans le dernier texte, le poète emporte son secret : il continuera à avancer et laissera l’eau de la « rivière noire » noyer son cœur. Ayant déjà senti dans l’eau la pourriture et l’angoisse mortifère, il accepte cette fatalité. Alors, avec l’ironie amère des désillusions, il conclut sa série de poèmes en s’accordant un visa tibétain de soixante-sept ans.
Par contre, les poèmes de Ma Lihua démontrent la supériorité de grand Han, les Chinois, qui, venant de l’extérieur, défient dans la solitude l’immensité de la Nature[31]. « Du bout de cette route jusqu’à l’autre bout, avance à l’appel de l’époque, couvert des traces de l’époque/ je suis jeune, pur et plein de vie/ sans souci, sans crainte, ignorant, naïf/ nous avançons vers le plateau tibétain laissant nos chansons joyeuses…/ le vent emporte nos âmes vers nos pays natals » [32]. De façon plus intime et plus poignante, les poèmes militaires de Yang Xianmin mêlent la force de l’héroïsme à la nostalgie de l’exilé : «Je veux utiliser la pointe de mon fusil pour enlever un bout de l’arc-en-ciel/ je suis certain qu’un jour, il reliera mon pays natal et le pays étranger…Un vent violent efface la couleur fraîche de mon nouvel uniforme / ah! Où est la plus douceur de mon pays natal? »[33] De plus, empruntant l’image d’une déesse, les strophes de Yu Si révèlent le conflit entre la souffrance du mal de pays et l’identité militaire au Tibet : « elle est enfermée dans par les montagnes/ qui peut l’apporter pour le pays? /lointain, qui ente sa voix? /mourir en souriant pour la gloire de notre époque » [34]. Le poète de la première génération Gao Pin rejoint le sentiment de ses cadets comme l’indique l’un de ses vers écrits en 1988 : « Le Tibet est le synonyme de la souffrance »[35].
a) Le mal du pays
Cela dit, les jeunes colons chinois ont également recours à la prose pour exprimer leurs sentiments. Une sorte de nouvelle-reportage commence à paraître, offrant un paysage narratif très varié et personnalisé[36].
Le court roman de Sun Dannian, une Chinoise immigrée au Tibet, porte un titre emblématique de la thématique qui le parcourt : Maladie de nostalgie du pays natal. La souffrance de l’exilée est exprimée sans ambages, dès son entrée dans la chambre rustique qui lui était imposée à Lhassa. La description du décor laisse deviner que la narratrice ne désire guère se tarder en ce lieu pauvre, sombre, monotone, perdu, triste et rustique. Dès la première page, le lecteur s’interroge sur les raisons qui ont poussé la narratrice à accepter la proposition du gouvernement de rester cinq ans, huit ans, voire plus au Tibet. Depuis deux ans déjà, elle s’y est installée et n’a pas vu le temps passer. Elle se trouve dans un état de confusion, la vie n’a concrètement pour elle aucun sens. De toute manière, n’est-elle pas emportée comme une feuille au gré du vent ? Elle demeure apatride et n’a trouvé aucun endroit où s’enraciner. La souffrance singulière qu’évoque la narratrice a pour origine la quête d’un lieu où se poser de manière définitive. Le « je » narratif manifeste un sentiment finalement aux antipodes de l’héroïsme. L’arrivée au Tibet ne chante plus la gloire du PCC mais pleure la souffrance de l’individu perdu.
De même, l’œuvre de Li Yaping révèle une souffrance directement liée à l’idéologie de la sinisation en racontant la tragédie d’une héroïne chinoise, Jiang Ying, au Tibet.[37] Diplômée en médecine, Jiang Ying s’installe en 1953 avec son mari dans l’ouest du Tibet, où tous les deux travaillent à l’hôpital. L’auteur décrit d’abord la souffrance d’une mère qui doit élever ses trois enfants en se contentant de les voir une fois tous les deux ans. Le cas de Jiang Ying est généralisé chez les colons chinois installés au Tibet : ils souffrent d’être séparés de leurs enfants éduqués en Chine. Le sujet relève d’une préoccupation collective mais, rarement traité dans la littérature chinoise au Tibet, il semble tabou. La souffrance de Jian Ying en tant que mère se double d’ailleurs de la douleur d’une épouse : au cours de la Révolution culturelle, son mari, un pédiatre brillant, calomnié par ses propres collègues de travail, a fini par se jeter dans un puits. Il est interdit à Jiang Ying de protester ni de montrer son chagrin, ni même de revoir, pendant trois ans, ses enfants restés au pays natal. Avec une ironie acerbe, l’auteur raconte les efforts de la malheureuse pour devenir membre du PCC ; depuis 1956, elle travaille d’arrache-pied pour en être digne ; et pourtant, elle devra attendre vingt-sept ans pour être enfin acceptée, juste avant de mourir. Le véritable objectif de ce « reportage » littéraire est donc de rendre hommage aux nombreux colons chinois au Tibet qui ont sacrifié leur vie à l’application scrupuleuse de l’idéologie de la sinisation.
Le triste sort de Jiang Ying invite aussi tous les colons chinois vivant au Tibet à méditer leur propre destin. La nouvelle « Apparition de la lune »[38] explique la souffrance des amoureux éloignés l’un de l’autre, comme celle d’une paysanne chinoise et d’un militaire qui perdra la vie en faisant son service au Tibet. Le roman Raison pour le Tibet publié en 1998[39] aborde bien ces mêmes difficultés émotionnelles en racontant le service de quatre diplômés d’université qui ont signé un contrat de huit ans. Les raisons de leur souffrance sont multiples : l’éloignement familial, une santé qui se dégrade, la crainte de décevoir le gouvernement si le contrat n’est pas respecté. A la lecture de leur quotidien, on en conclut que la vie des Chinois au Tibet n’est que peine perdue car les personnages du roman sont obligés de sacrifier leur jeunesse à l’idéologie : le Tibet est un paradis pour les touristes, mais l’enfer pour les Chinois immigrés[40]. Comment se situer quand on est une immigrée comme Li Die ? Lorsqu’elle est en vacances au pays natal, elle perd ses points de repère ; au Tibet, elle ne sent pas chez elle ; où donc demeurer ? Quelle est sa véritable identité ? Les doutes l’assaillent à la rendre malade. La question de l’identité se pose chaque jour et la Chinoise du Tibet est impuissante à maîtriser la situation.
Le manque d’amour
Vivre au Tibet, c’est vivre sans amour pour la plupart des Chinois immigrés selon les textes littéraires de cette époque, où la souffrance de ne pas pouvoir aimer ou de ne pas pouvoir être aimé est un thème fréquent. La nouvelle intitulée « Bise du pays de neige »[41] évoque cette carence chez les jeunes soldats, isolés par des milliers de kilomètres qui les séparent de leurs proches, coincés dans les hautes montagnes enneigées. La visite d’une stagiaire dans une poste à la frontière vient troubler ces militaires qui n’ont pas vu de femme depuis au moins deux ans. Durant les trois jours qu’elle passe parmi eux, la jeune ne leur pose qu’une seule question qui pique le cœur de chaque soldat comme une aiguille : As-tu une amoureuse ? Le jour de son départ, la jeune stagiaire donne un bisou à chaque soldat, ersatz dérisoire face à un manque d’amour cruel.
Plus près de nous, et selon une appréhension toute tchekhovienne du manque d’amour, la nouvelle « Sentiment prouvé »[42], publiée en 2004, montre que le besoin d’amour va parfois jusqu’à mettre le protagoniste dans un état psychologiquement anormal. Guo Min, diplômé de l’université, se porte volontaire pour investir sa jeunesse et sa compétence dans l’exploitation de la plus grande mine de bronze au Tibet. Il s’installe donc dans la ville de Chang, où il ne craint ni le manque des légumes frais et de dentifrice, ni l’éloignement de sa famille. A l’université, il collectionnait les conquêtes féminines et ce séducteur ne peut imaginer travailler dans un endroit où il n’y aurait pas de femmes chinoises. Sur la route de l’exil, il rencontre une Chinoise Tian Xin, sa future collègue dans la mine. Comme elle est la seule Chinoise à sa disposition, Guo Min séduit immédiatement Tian Xin qui se sent fière et heureuse, car durant les quatre années qu’elle a passées à l’université, aucun garçon ne s’est intéressé à son physique disgracieux. Rapidement, Guo Min tombe malade et Tian Xin passe ses nuits à jouer aux cartes avec les hommes. Tous les jours à 21h15, Guo Min attend le retour de Tian Xin. En vain. Quelques mois plus tard, Guo Min est sans nouvelle de Tian Xin qui vit déjà avec un autre homme. Guo Min attend toujours le regard fixé au plafond de sa chambre rustique qu’il se met soudain à aimer. Un jour, un collègue lui téléphone et lui annonce, tout ému de la nouvelle, que les dirigeants ont décidé de faire venir une vingtaine de jeunes Chinoises diplômées à la mine, mais Guo Min a déjà perdu le goût de vivre; il meurt en regardant le plafond de sa chambre solitaire du Tibet.
La nouvelle identité: l’aventurier et le chasseur de trésors
Les parents éloignés de leurs enfants et le célibataire en mal d’amour ne sont pourtant pas les seules figures à exposer les difficultés rencontrées par les colons chinois au Tibet. Dès 1988, dans la nouvelle « Toile sans peinture »[43], où Liu Wei met en scène un groupe de personnages, il s’agit encore de jeunes diplômés chinois vivant à Lhassa, mais ceux-ci y sont attirés par le goût de la découverte personnelle. La ville est un théâtre où les personnages vivent à leur manière, décalés. Xinye, le personnage central, un peintre chinois, vit à la mode occidentale. Comme ses amis, il est attiré par l’exotisme tibétain : objets divers, ancienne monnaie, sculptures en argile, et il s’intéresse tout particulièrement, comme eux, aux squelettes tibétains utilisés pour les rites funéraires. Chaque rencontre entre Xinye et ses amis est l’occasion de comparer leurs collections. Avec fierté et un certain sens de l’aventure, ils racontent chacun à leur tour comment ils ont déniché leurs trésors.
L’auteur introduit alors dans l’histoire des Tibétains opposés à la modernisation afin de montrer à quel point ils sont aujourd’hui sinisés. Il y a d’abord la Tibétaine primitive dont Xinye fait sa petite amie. Puis, un jeune Tibétain Jia Cuo à qui Xinye apprend la peinture. Leur relation est celle nouée entre un maître et son élève. Mais il existe une incompatibilité entre les personnages. Jia Cuo apparaît encore plus « rustique » que la petite amie de Xinye, comme le montre la scène où Jia Cuo fait l’amour en se trompant de partenaire. La nouvelle s’apparente à une fresque aux images crues et, pour les corser encore un peu plus, Liu Wei joue sur les registres sensoriels en associant des odeurs douteuses à l’évocation des paysages. Le comportement des deux « Tibétains » qu’il côtoie au quotidien met en évidence la souffrance de Xinye ; elle est certes atténuée par sa passion pour les objets singuliers, mais les colons chinois ne sont-ils pas présentés comme écartelés entre l’envie de posséder toutes les richesses du Tibet et les ravages psychologiques d’un séjour prolongé dans un pays où ils ont du mal à s’adapter, dans lequel ils ressentent immanquablement les affres de l’exil ?
Le court roman Fureur[44] présente une autre manière de compenser la douleur de vivre loin de sa culture d’origine au Tibet. Le narrateur, un Chinois migrant sans diplôme qui raconte son histoire à la première personne, a pour seul objectif de s’enrichir matériellement en arrivant au Tibet. En deux années à peine, il tue un homme pour son argent, se cache dans le nord-ouest du pays, devient le chef de la mafia chinoise, ouvre une maison close et y fait venir des jeunes femmes chinoises—, même des diplômées de l’université—, et il réunit des délinquants chinois pour attaquer les convois et les touristes, après avoir pris soin de corrompre la police locale. Pour éviter les complications, il demande de ménager les autochtones. Les péripéties du récit guident le lecteur au cœur d’un Tibet troublé par des malfaiteurs chinois : on n’y trouve plus de relents de la propagande qui invite à construire un autre Tibet moderne.
Le Tibet sous la plume des Chinois de Chine
Depuis l’installation du pouvoir du PCC au Tibet, le pays en neige est à la fois un sujet politique auquel les instances du pouvoir doivent répondre et un sujet exotique pour les intellectuels n’ayant pas l’occasion d’y vivre. Traiter le sujet du Tibet et s’inspirer de ce lieu sont considérés comme étant des assurances de l’innovation tant au niveau du contenu qu’au niveau de la forme, et son traitement thématique répond bien à l’attente des dirigeants chinois. Voici l’exemple de trois écrivains chinois célèbres : Zhang Xiaotian, Wang Meng et Su Yang ont chacun publié un court roman sur le Tibet sans véritablement y habiter. Dans le roman de Zhang Xiaotian qui s’intitule Ouverture d’un document secret,[45] l’héroïne, Ge Yilan, est surnommée « la libératrice sexuelle ». Après une vie d’échecs successifs aux U.S.A., cette Chinoise part pour le Tibet qu’elle considère comme l’endroit le plus pauvre du monde, un enfer aux antipodes du paradis américain. Elle devra y vivre pour expier l’une de ses fautes : avoir trompé son mari qui s’est plongé alors dans l’univers de la drogue. Souffrir parmi les Tibétains qui endurent eux-mêmes une vie rude depuis les temps les plus reculés lui apporte de l’apaisement, non sans orgueil. Car, si elle a échoué dans son rêve américain, elle atteint une espèce de rédemption en s’imposant une vie de souffrance au Tibet.
L’ancien ministre de la culture et de la propagande, Wang Meng, raconte une trajectoire inverse. En janvier 1985, il publie dans la revue officielle Littérature du peuple[46] son roman Vent du haut plateau. Inspiré par un voyage de quelques jours au Tibet, ce texte raconte les mésaventures d’un couple chinois. Issu d’une famille aisée, Long Long n’a aucun projet de métier : il passe son temps à rêver d’une vie moderne. Grâce à la richesse de son père, il ne manque pourtant de rien jusqu’à ce qu’il tombe amoureux de Xiao Li qui avait quitté la ville pour s’installer à la campagne pendant la Révolution Culturelle, répondant ainsi à l’appel de Mao Zedong encourageant tous les diplômés à être rééduqués par les paysans. Durant cette période, Xiao Li vivait selon les préceptes d’un fanatisme idéologique et avait donné naissance à un enfant hors mariage. Long Long s’éprend de cette femme de quatre ans son aînée dès leur première rencontre. Il décide de tout abandonner et de partir, avec Xiao Li, vivre parmi les Tibétains. Celle-ci souhaiterait plutôt s’installer aux U.S.A., mais avant d’y aller, elle veut bien vivre avec les Tibétains pour connaître l’expérience de l’extrême pauvreté, pour mieux goûter par la suite au paradis américain. Aller au Tibet est aussi une manière de suivre la politique du gouvernement et d’aider les pauvres Tibétains à sortir de leur souffrance. Le père de Long Long, haut fonctionnaire du gouvernement central, n’approuve pas la décision de son fils et considère qu’il se berce d’illusions, sinon de snobisme. L’influence de Wang Meng, à la fois homme de lettres et homme politique, a beaucoup contribué à la diffusion du thème tibétain.
Chez d’autres écrivains, le Tibet apparaît également comme un purgatoire. C’est en 1984 que Su Yang publie, dans le premier numéro de la revue littéraire officielle Le contemporain, son roman intitulé Le pays natal. Il y est question d’un jeune et brillant médecin nommé Bei Tianming. Sa femme, une amie d’enfance, est atteinte d’un cancer. A cause de sa maladie, elle a quitté les U.S.A. pour retourner dans son pays natal. Après une séparation d’une vingtaine d’années, Bei Tianming et la jeune femme font un mariage heureux. Malheureusement, le jeune homme se retrouve veuf. Vivre seul lui est une souffrance insupportable, mais il ne peut pas accepter l’amour d’une autre femme car, lorsqu’il postule pour être chef de service, les autres critiquent sa vie privée. Pour trouver une issue à cette situation, il décide alors d’aller au Tibet où il vivra dans le dénuement complet et s’infligera la souffrance physique de la pauvreté qui pourra peut-être apaiser sa souffrance morale. L’intérêt de cette histoire ne réside pas uniquement dans le destin du personnage, mais aussi dans la solution que l’auteur envisage pour lui. Su Yang présente le Tibet comme un bagne pour les Chinois, mais, n’y ayant jamais vécu, son roman ne propose qu’une échappatoire imaginaire pour ceux qui ne trouvent pas d’autre issue à leur vie dans leur pays d’origine.
Dans l’esprit de ces trois écrivains chinois contemporains, le Tibet constitue un endroit hostile. Ainsi, chaque fois qu’un personnage se trouve dans une situation inextricable, le Tibet, pays de haute altitude à l’oxygène raréfiée, devient un refuge infernal mais incontournable, d’autant plus qu’au-delà de la souffrance, il offre un dépaysement magnifique.
Xu Mingxu, critique littéraire chinois immigré au Tibet, dénonce chez ces trois écrivains un manque de respect à l’égard des intellectuels chinois qui vivent au Tibet—, ou encore à l’égard de tous les jeunes Chinois venus en ces lieux dans le but louable d’aider à la construction d’un pays moderne[47]. Xu Mingxu souligne par ailleurs les lacunes de ces textes d’écrivains qui connaissent mal la réalité de la vie au Tibet. Selon lui, les personnages dans leurs œuvres n’ont été créés que pour suivre la mode et rejoindre les lecteurs. Il leur reproche de négliger la nouvelle génération intellectuelle chinoise vivant au Tibet qui, en lisant de telles fictions, n’y retrouvent que des ratés, des hommes en quête de refuge ou des utopistes. En fait, le propos de Mingxu sont provoqués par une réticence à être mis sur le même plan que les protagonistes de ces trois écrivains. Il se présente comme le porte-parole de tous les intellectuels chinois vivant au Tibet, et il indique clairement que ni lui ni ses confrères ne connaissent la souffrance et les difficultés auxquelles sont confrontés les personnages romanesques. Même s’il insiste aussi sur les rudes conditions de vie dans l’environnement tibétain, et s’il reconnaît que les Chinois vivant au Tibet souffrent au quotidien, il affirme que son départ pour le Tibet n’était pas motivé par des troubles personnels.
L’opinion de Xu Mingxu ne fait guère l’unanimité. Depuis les années 80, d’autres auteurs d’origine chinoise vivant au Tibet dénoncent la souffrance engendrée par l’idéologie héroïque et par les difficultés de vivre au Tibet. C’est le sujet principal de cette littérature, dite « littérature chinoise coloniale au Tibet ». Les auteurs s’attachent à décrire les coutumes et les paysages tibétains, mais, saisis par la peur de s’éloigner de la vie moderne, ils expriment aussi leur angoisse et leurs doutes. Ces jeunes Chinois immigrés au Tibet, ne peuvent renier leur devoir politique[48]. C’est alors que leurs œuvres deviennent une sorte d’exutoire, destiné à leur permettre de manifester leurs sentiments personnels et également à leur servir de réconfort où ils s’appuient sur l’interprétation idéologique du passé tibétain.
Conclusion
Née du but politique d’occuper une terre étrangère et difficilement domptée, et œuvrant au service de l’idéalisme colonial, la littérature chinoise coloniale au Tibet enregistre principalement la souffrance de la vie quotidienne et les difficultés psychologiques des colons chinois. Cependant, elle sert aussi comme un outil de révélation du sentiment personnel opposant l’héroïsme fanatique du PCC, surtout sous la plume des écrivains de la seconde génération. Que le lecteur favorise la poésie ou la prose, il ne peut s’empêcher de ressentir de la pitié pour les milliers des colons chinois ayant sacrifié leur vie à l’idéologie politique. Cette littérature finit par devenir en elle-même une ressource de survie : les auteurs chinois plus récents s’identifient étroitement donc à une écriture personnelle. Mais, somme toute, les aspects éthiquement douteux de la « mission civilisatrice » chinoise engendrent une souffrance qui finit également par humaniser ceux qui y participent. Avec orgueil, les auteurs chinois recourent à la poésie, à l’écriture romanesque, tout à la fois consolatrice et utilitaire, pour exprimer les périls de la vie quotidienne, l’isolement du travail, la séparation des proches—, enfin bref, la nature de leur épreuve. Dans leurs œuvres, requêtes et suppliques se mêlent aux descriptions, aux plaintes et aux démonstrations d’affection. En ce sens, la littérature chinoise coloniale n’est plus simplement un outil au service de l’héroïsme idéologique, mais un miroir où se reflète la souffrance inconsolable dans la colonisation au Tibet.
Footnotes
- Elleke Boehmer, Colonial and postcolonial literature: migrant metaphors, Oxford University Press, 1995, p. 27.
- D’après le légender populaire, qu’en 641, afin d’avoir une relation amicale entre le Tibet (sous le nom Tubod à l’époque) et la Chine, l’empereur fondateur de la dynastie des Tang Taizong a épousé une princesse Wencheng avec le roi tibétain Songzan Ganbu. Avant de quitter la Chine, la princesse a reçu un miroir de la part de sa mère. Cette dernière lui a dit si la princesse pense à sa famille, elle pourrait regarder le miroir. Après le long voyage, la princesse est arrivée à la frontière entre le Tibet et la Chine, le département chinois actuel : Qinghai. Poussée par la tristesse de séparer avec la famille, la princesse regarde dans le miroir. Elle ne voit qu’une femme inconnue fatiguée et ridée. Très choquée par l’image, elle jette aussitôt par terre le miroir qui se transforme en une montagne au milieu d’une rivière. Les gens nomment cette montagne du soleil et de la lune qui était le nom du miroir. A cause de la montagne, l’eau de la rivière retourne dés lors vers le lieu de son départ. En donnant le nom Daotang à la rivière, les gens disent que l’eau de la rivière est l’arme de princesse, et, que la montagne empêche désormais le retour au pays natal de princesse. En 710, en suivant le destin de Wencheng, la princesse Jincheng a épousé le roi tibétain Cisong Dezhan. La montagne du soleil et de la lune avec la rivière Daotang se trouvent à proximité du chemin du fer vers le Tibet dans la région de Qinghai.Voir le site historique chinois : www.hottx.net/hyl/20118/116258_3htm11112013
- Rolf A. Stein, La civilisation tibétaine, Paris, L’Asiathèque, 1987, p.2.
- Ses chaînes de montagnes sont de véritables barrières naturelles qui atteignent en moyenne 4000 mètres de haut et de nombreux fleuves orientés nord-sud coupent les voies d’entrée à l’est et à l’ouest. L’accès de ce territoire de 3.800.000 km2 (sept fois la France) est donc particulièrement difficile.
- Xu Huaxin, Xizang zizhiqu dili (Géographie de la région autonome du Tibet), Lhassa, Renmin chubanshe, 1986, p.198.
- Service de la propagande du gouvernement chinois au Tibet, Liangtiao tongwang Xizang zizhiqu de gonglu luocheng huiyilu (Trente ans de souvenirs sur les travaux de la construction des deux routes reliant le Tibet), vol 1, Lhassa, Renmin chubanshe,1984, p.12.
- Charles Ramble, Tibétains 1959-1999 : 40 ans de colonisation, Pais, Autrement, 1998, p.10.
- Mao Zedong, le poème «Longue marche», octobre1935.
- Mao Zedong, Anthologie des articles de presse de Mao Zedong, Beijing Xinhuachubanshe, 1983, p.245, p.259.
- Li Xinyu, L’évolution des poèmes contemporaine chinois, Hangzhou, 2000, Presses de l’Université de Zhejiang, p.6.
- Jie fangjun wenyi (L’art de l’armée populaire de la libération), Beijing, 5/1952.
- Service de la propagande du gouvernement chinois au Tibet, Liangtiao tongwang Xizang zizhiqu de gonglu luocheng huiyilu (Trente ans de souvenirs sur les travaux de la construction des deux routes reliant le Tibet), vol 1, Lhassa, Renmin chubanshe,1984, p.89.
- Elleke Boehmer, op. cit. p.38.
- La revue littéraire tibétaine, version chinoise Xizang wenxue 西藏文学, Lhassa, 8 /1987, p.3.
- Cette propagande comprend évidemment une multitude de journaux et magazines, parmi lesquels : Journal quotidien du Tibet, Journal des soldats en haute plateau, Journal de frontière, Journal de front, Les arts de la frontière, L’art de l’armée de la libération, Magazine des images de l’armée de la libération et Magazine des images de nation.
- Jean-Marie Seillan, Aux sources du roman colonial (1863-1914): l’Afrique à la fin du XIXe siècle, Paris Karthala, 2006, p.30.
- Xu Huaizhong, 我们播种爱情Nous semons l’amour. Au début, ce roman a été publié en série par la revue mensuelle《 l’art de l’armée populaire de la libération解放军文艺》entre nov.1956 et juin. 1957, puis édité par les deux maisons des éditions Zhongguo qingnian chubanshe et renmin wenxue chubanshe à Beijing en 1959.
- Roland Barthes, Mythologies, Paris, Editions du Seuil 1957.
- Elleke Boehmer, op.cit., p.46.
- Liu Ke, Anthologie des nouvelles«Yang Jin», Beijing, éditions de l’armée de la libération, 1962.
- Yang Yang, Journal quotidien du peuple, Beijing, 10/11/1962, p.5.
- Noël Dutrait, Petit précis à l’usage de l’amateur de littérature chinoise contemporaine, Arles, Philippe Piquier, 2002, p.5.
- Ma Lihua, 雪域文化与西藏文学La culture du pays de neige avec la littérature au Tibet. Changsha, Hunan jiaoyu chubanshe, 1998, p.77.
- Idem, p. 92.
- Xizang wenxue西藏文学1/1988,p.8;
- Idem.
- Idem.
- Xizang wenxue西藏文学1/1988, pp. 2-6. Pour la première fois, il publie sous son vrai nom, Wu Yuchu.
- Cette critique a été publiée dans le même numéro de la revue qui contient la série de Wu Yuche. Elle s’intitule: « tuishi de shenhua he zou xiang shenhua de lige : lun zushi «heise de he liu» jian qita褪色的神话 走向深化的骊歌 论‘黑色的河流’ 兼其它 (la mythologie disparaît avec la chanson qui est le vecteur: critique sur la série des poèmes : la rivière noire avec autres choses)», in Xizang wenxue西藏文学, 1/1988, p. 7-9.
- Les autres poètes colons chinois de cette époque sont: Yu Si (Cai Chunfang), Wei Fu, Wei Zhiyuan, Liu Zhihua, Zeng Youqing dont certains sont des militaires.
- Mo Li, la revue Ouverture, Hong Kong, 12/2008.
- Ma Lihua, La culture du pays de neige avec la littérature au Tibet, op. cit., p.219-220.
- Yang Xaionmin, Xizang wenxue, 5/1984, pp.33-34.
- Gao Pin, Xizang wenxue, 09/1988, p.42.
- Idem. .
- Ma Lihua, idem, p.91.
- Li Yaping, «Lin Yaping» la revue Xizang wenxue01/1984.
- Feng Liang,«月亮升起来了Apparition de la lune», Xizang wenxue,11/1987, pp.7-9.
- Meng Meiying, 西藏缘Raison pour le Tibet, roman en série, Xizang wenxue, 2/1998, pp.109-129.
- Idem.
- Ren Shanjun, «隐含着痛苦:关于西藏之美的思考La souffrance cachée: réflexion sur la beauté du Tibet», in www.wenming.cn 21/12 2009.
- Zhang Zuwen, «情感认证Sentiment prouvé)», Xizang wenxue, 02/2004, pp.50-54.
- Liu Wei, «没有油彩的画布Toile sans peinture», Xizang wenxue,3/1988,pp.14-21.
- Xizang wenxue, 06/1992, pp.24-32.
- Il a été publié dans la revue littéraire Changchun, 4/1983, pp. 2 -16. Cette revue est éditée par le Comité des artistes de la province du Jilin. «Changchun» est le nom de la capitale de cette province.
- Renmin wenxue (la littérature du peuple), 1/1985, pp. 7-21.
- Xu Mingxu, «ping neidi xiaoshuo zhong de «jin Zang re» 评内地小说中的‘进藏热’ (Critique sur la mode du départ pour le Tibet dans les romans chinois», Xizang wenxue西藏文学8-9/1985, pp. 119 – 120. Dans les années quatre-vingt-dix, une nouvelle population entre au Tibet pour rechercher l’exotique tibétain. Ce sont principalement des touristes. Parmi eux, certains écrivains profitent de l’occasion pour trouver une inspiration dans l’exotisme culturel ou géographique. Un exemple concret se trouve dans le roman de Wang Chao. Il y met en scène deux jeunes artistes provinciaux, qui vivent confortablement à Pékin. C’est alors qu’un accident de la route bouleverse leur vie. Ce n’est qu’au Tibet, pays des dieux et des saints, de la pureté naturelle, qu’ils retrouveront, chacun à leur manière, la paix. Ce roman est calqué sur celui de Wang Meng et de Su Yang.
- Le livre de Wang Lixiong consacre de nombreuses pages aux témoignages de colons chinois au Tibet et de leurs proches sur les souffrances qu’ils endurent. Wang Lixiong, Sky Bural: The Fate of Tibet, pp. 342 – 349.