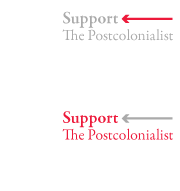Photo Source: hassanmusa.com
[U]ne image, dans le fond, c’est comme une bouteille à la mer. J’écris un message que je mets dans une bouteille, que je lance à la mer. Elle peut arriver chez quelqu’un qui ne peut pas lire mon écriture ou chez quelqu’un qui me lit mais qui ne comprend rien à ce que je lui dis.
- Hassan Musa [1]
Mondialement connu grâce à sa participation à des expositions internationales d’envergure, notamment Africa Remix et la Biennale de Venise, Hassan Musa pratique la performance, la calligraphie, la peinture, la tapisserie, l’illustration et l’aquarelle tout en restant fidèle à lui‑même. Né à El Nuhud (le Soudan) en 1951, cet artiste transnational a l’originalité de remanier les grands « classiques » de l’histoire de l’art occidental pour y superposer la vision contemporaine que peuvent en avoir les ressortissants de pays postcoloniaux. Sur ses images, les figures adoptent essentiellement deux postures : les unes luttent debout contre des forces invisibles — à savoir, l’imposition des idéologies monolithiques de l’Occident et le regard objectivant du marketing —, les autres s’allongent sous des mots qui transforment les lieux communs et idées reçues de ces mêmes forces en miroirs d’une critique lancinante.
Jamais Musa ne perd de vue la nécessité de l’engagement artistique dans un monde miné par l’avarice du capitalisme international débridé, ainsi que par la violence que celui-ci engendre sous les multiples visages de la foi, non seulement la foi religieuse, mais aussi la naïveté de certaines convictions politiques, le culte du marché de l’art et la loi de la pensée unique. En effet, il lui arrive souvent de reprendre à son compte la célèbre phrase de Kateb Yacine, « la langue française est un butin de guerre.[2] » À cela, il ajoute néanmoins que la richesse glanée de la domination culturelle englobe également, pour lui, l’ensemble de la tradition occidentale, y compris les balises symboliques et références historiques en arts visuels. L’art est donc violent chez Musa parce qu’inévitablement héritier d’une histoire violente.
Cet adepte du détournement de l’objet a étudié d’abord à l’École des beaux-arts de Khartoum, de 1970 à 1974, avant d’obtenir en 1989 son doctorat de l’Université de Montpellier. Après avoir travaillé à la télévision soudanaise et aux Presses universitaires de Khartoum, il est devenu, en France, enseignant d’arabe et d’arts plastiques. Jusqu’à nos jours, il continue à animer ponctuellement des ateliers de calligraphie pour les jeunes et pour les adultes.
Avec Chéri Samba, Rachid Koraïchi et Ousmane Sow, Hassan Musa compte aujourd’hui parmi les artistes contemporains les mieux connus dans le monde francophone. Si l’art est d’abord et avant tout pour lui une forme d’action, cela ne l’empêche pas de manier les mots avec une rare finesse philosophique et littéraire. Dans la métaphore filée citée en exergue, l’image, telle une bouteille à la mer, devient progressivement écrit, message et parole. Voilà pourquoi il semblait pertinent de lui poser quelques questions sur ses pratiques artistiques.
*******
Alisa Belanger : Vous vous décrivez comme un « créateur d’images » ou, parfois, un « faiseur d’images ». Évidemment, ces deux descriptifs sont plus aptes à saisir la mouvance de vos multiples pratiques artistiques que des termes plus spécifiques, tels que « peintre » ou « calligraphe », mais pourquoi ne pas simplement vous désigner comme « artiste » tout court ?
Hassan Musa : Dans l’expression « faiseur d’images » il y a le principe de faire qui ancre la réflexion artistique (lire : spirituelle) dans la dimension réelle. Quand je me désigne comme faiseur d’images, je m’inscris dans une lignée de « faiseurs » qui gèrent les relations de l’espace concret (volume, vide, couleur, lumière, textures…). Ce sont des êtres qui réfléchissent avec la matière pour faire voir l’invisible.
Je trouve la qualité de « faiseur d’images » plus précise que celle d’« artiste ». Les artistes, dans mon imaginaire, sont des personnages romanesques. Ce sont des êtres extraordinaires (lire : des prophètes ou des chamanes !) qui peuplent la littérature européenne. Joseph Beuys, Che Guevara, Antonin Artaud, Vincent Van Gogh sont des prophètes. Moi, je me vois du côté des Antonio Tapies, Cy Twombly, Francis Bacon, Henri Matisse, Paul Klee, Edward Manet, C. Monet, Rembrandt, Vermeer jusqu’à Hokusai, mais aussi John Ford, Federico Fellini et Akira Kurosawa, ou également Tex Avery et Walt Disney.
AB : Vous avez toujours privilégié le savoir‑faire tactile de l’artiste, c’est-à-dire le travail à la main. Seriez-vous un jour apte à vous lancer dans la création numérique, aussi ? Pour vous, relève-t-elle davantage des courants « matérialistes » ou « conceptuels » ?
HM : J’ai toujours eu du mal à accepter l’opposition entre « art conceptuel » et art autre qui serait « fait main », d’une part parce que je crois que la catégorie « art conceptuel » (« Art as idea as idea ») n’est possible que par opposition/comparaison avec cet art « fait main », « matérialiste », « concret » ou « tactile », d’autre part parce que l’art, par définition n’est possible qu’en tant que pratique conceptuelle.
Cependant, je vois votre interrogation comme une réflexion sur la question du médium. La présence du médium appartient au domaine du « non verbal », ou de ce qui échappe à la portée des mots, sans que cela se limite aux objets concrets. Je pense que ce qui est non-verbal constitue le sens profond de mon travail plastique. Ce que j’entends par « non-verbal » vient de la dimension visuelle qu’imposent au regard la matière visible concrète et la matière imaginable (le hors-champ).
L’œuvre plastique est un objet donné à voir. La présence d’objets sonores dans certaines créations contemporaines me gêne car j’y vois comme une aberration méthodologique, un supplément sans nécessité. Cela vient peut-être de mon expérience de la peinture dite « moderniste ». Dans mon apprentissage de la peinture, j’appréciais la rigueur méthodologique de la peinture « pure (?) » selon les principes de Clement Greenberg. Mais cette peinture « pure », qui assure une continuité sans faille dans l’histoire de la peinture européenne (de Monet à Pollock), n’est qu’une utopie de « la purification esthétique » (si vous me pardonnez cette expression). Une utopie faussée par le regard qui, selon la qualité du « regardeur », entraîne le doute et la suspicion, voire même le rejet de la proposition initiale.
Bien entendu, je pourrais faire ces images autrement que par la peinture (montage photo, ordinateur…), mais, si je favorise l’emploi de la peinture, c’est peut-être parce que la peinture, pour moi, ne se limite pas à un médium parmi d’autres, mais c’est Le Médium que je connais mieux que les autres. C’est aussi le médium qui me permet ce « plaisir » particulier qui consiste à exercer un contrôle sur la totalité du processus qui mène à l’œuvre. J’ai une grande admiration envers ces artistes des 16e et 17e siècles qui, dans leurs ateliers, préparaient leurs pigments, leurs supports et fabriquaient leurs images tel un cuisinier qui fait pousser ses légumes dans son jardin avant de les préparer. La « main » du peintre n’est pas seulement un outil qui fait les traits, mais également « la manière » qui garantit la singularité de la création. C’est une identité.
La peinture me fascine par sa simplicité apparente et par sa complexité cachée. Le fait de penser que, dans le champ de la peinture mille fois ratissé, tout a été fait et qu’il n’y a plus rien à glaner, représente un défi stimulant. Un peintre d’aujourd’hui est, par définition, un glaneur têtu qui prétend que non, il y a peut-être encore quelques trésors cachés que les autres n’ont pas découverts.[3] La figure de glaneur qui fouille dans la poussière me fait suivre les pistes les plus diverses et faire les rencontres les plus surprenantes.
Je pense que mon travail actuel avec les tissus assemblés et cousus à la machine à coudre est une évolution naturelle de mes recherches sur la peinture. Les couleurs et les textures des tissus (imprimés, monochromes, transparents, opaques, brillants…) m’ouvrent des pistes inattendues sur le terrain de la réflexion plastique et me permettent de créer des images nouvelles. Ainsi, je vois mes images composées de tissus assemblés plus comme des variantes de mes peintures que comme une exploration d’un nouveau médium.
AB : Comment envisagez-vous l’avenir de la calligraphie et des arts du livre face à l’hypertexte ?
HM : J’espère que la technologie aidera les gens à se libérer du poids du modèle de la belle écriture officielle qui se dit « calligraphie » et qui est monopolisée par une élite d’artisans qui se disent « calligraphes », afin que chacun revienne vers l’écriture en tant que création graphique libre.
AB : Lors d’un entretien en août 2005, vous avez dit : « Je marque toujours le titre en grand, pour qu’on ne s’y trompe pas. [...] Quelque part, faire figurer le texte, c’est un geste complètement désespéré par rapport aux images ![4] » Cela dit, vos titres, situés à mi‑chemin entre le slogan commercial ou politique, la citation ironique et le vers lyrique, ont souvent une valeur poétique qui dépasse la simple transmission du message. Citons par exemple L’origine du Tiers-Monde (1997), Confusion de part (2003), ou I laugh you with my Ford… (2011). Quelle est votre conception du rapport global entre le texte et l’image, y compris les autres mots inscrits sur la toile ?
HM : Je pense que les titres de mes images sont une recherche d’efficacité, car les images sont naturellement ambivalentes. La nature du regard qui se pose sur une image pourrait altérer sa portée morale, car le regard n’est pas neutre. Il est miné par les intérêts idéologiques divers. Lorsqu’on regarde le monde qui nous entoure, on est conditionné à ne voir que la part du monde qui nous intéresse. C’est là où l’orientation du regard devient un enjeu du pouvoir. Si j’arrive à vous faire voir ce que je vois, j’organise les priorités de votre regard et je vous empêche, peut-être, d’aller voir ailleurs les choses que je ne veux pas que vous voyez.
J’ai toujours trouvé suspecte cette sagesse chinoise qui dit : « Lorsque le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt ». Je pense que, dans un monde où l’interaction est constante, il est plus que nécessaire de regarder à la fois la lune, le doigt et le sage lui-même. Pour répondre à votre question sur la présence des mots sur mes images, je pense qu’au départ, je les ajoutais comme un élément littéraire supposé encadrer le regard du spectateur. Si le titre des œuvres est un genre littéraire à part, cette littérature particulière me permet des renvois esthétiques et des clins d’œil politiques qui donnent à mes images un certain humour. Puis, j’ai compris que les mots sur mes images ne peuvent pas échapper à la loi des images. Ces mots sont également des images et je les compose donc comme des images en relation avec d’autres images. Les peintres chinois traversent la frontière entre texte et image avec plus de spontanéité que les peintres européens. Peut-être que, dans l’esprit de la tradition chinoise, tout est texte.
Quand je dis que le titre d’une œuvre représente un genre littéraire méconnu, je pense à la poésie qu’on rencontre dans les noms des personnes ou les noms des lieux. Dans mes images intitulées : L’origine du Tiers-Monde (1997) et Confusion de part (2003), je cherchais à donner à voir la dimension politique contemporaine d’images importantes dans l’iconographie européenne. La misère du Tiers Monde est la partie sombre de la prospérité du monde industriel, tout comme les bateaux des naufragés africains à Lampedusa sont la version contemporaine du naufrage glorieux de « la Méduse ». Nous appartenons tous au même monde, nous avons tous la même origine et nous avons tous les mêmes désirs !
AB : À propos des traditions artistiques en Chine, comment êtes-vous venu à vous intéresser à l’aquarelle chinoise ? Comment votre voyage dans « le pays du milieu » a‑t‑il enrichi votre réflexion ou vos pratiques artistiques ?
HM : J’avais 12 ans. Je vivais dans une petite ville de l’ouest de Soudan, El‑Obeid. C’était l’époque de la Guerre Froide. Le Soudan, comme tous les pays du Tiers Monde, était inondé de matériel de propagande politique qui venait de l’Union Soviétique, de la Chine et des USA. Je me souviens d’un petit kiosque à journaux où nous allions acheter des revues illustrées et des bandes dessinées chinoises. C’étaient les publications les moins chères. Je collectionnais « La Chine Illustrée », un beau magazine rempli d’images qui vantaient la Révolution, la lutte anti‑impérialiste et la solidarité entre les peuples. J’y trouvais de belles reproductions des œuvres des grands maîtres de l’aquarelle chinoise. C’était mon école.
Je me souviens encore des difficultés insurmontables pour copier des aquarelles en utilisant des gouaches désobéissantes qui me donnaient une version bourbeuse de ces magnifiques paysages qui intègrent écriture et image de manière surprenante. À cette époque, j’ai appris que la pratique de l’aquarelle traditionnelle est une sorte d’écriture artisanale bien codée où des éléments picturaux (arbres, rochets, cascades) se répètent à l’identique d’une image à l’autre. Quand je suis allé en Chine pour la première fois en 2009, j’étais déjà assez informé sur les méthodes et les finalités de la pratique graphique chinoise. Cependant, la Chine reste un continent artistique à découvrir.
AB : Aujourd’hui, on note de plus en plus souvent l’essor des liens économiques entre la Chine et l’Afrique. Certains estiment même que ces rapports sino‑africains l’emportent de nos jours sur la vieille histoire de la Françafrique. Comment situez-vous donc votre production artistique vis‑à‑vis des rapports actuels entre « le tigre » et « l’autruche » ?
HM : La société chinoise vit une grande mutation qui affecte la politique, l’économie et la vie culturelle. La Chine est en train de devenir un membre dans le club des Puissants. Ce statut représente une grande responsabilité morale devant cette société chinoise qui doit choisir entre dévorer les faibles au festin du libéralisme, ou sauver le monde en restaurant les liens humains avec les autres. Je pense que la version globale de la lutte des classes se joue en Chine comme elle se joue entre la Chine et le monde euro-américain. Les Africains attendent donc les Chinois au tournant de leur humanité.
AB : Les inégalités économiques ne cessent de croître partout dans le monde depuis une cinquantaine d’années. Que peut l’art face à l’écart grandissant entre les riches et pauvres ?
HM : Si nous prenons la pratique artistique dominante comme modèle, l’art ne peut rien face à l’écart grandissant entre les riches et pauvres, parce que cet art‑là est l’art de la classe dominante. Pourquoi attendons‑nous des riches qu’ils acceptent une pratique artistique qui pourrait menacer leurs privilèges ?
Les pauvres du monde sont en train d’inventer une nouvelle forme d’expression artistique, basée sur le principe de la contestation de l’ordre établi. La contestation qui a démarré dans certains pays du Proche Orient a effrayé les riches du monde entier, car c’est une contestation de l’ordre du monde qui ne répond pas à la forme traditionnelle de la contestation (actions pacifistes, sans structure de leadership conventionnel, connectée, spontanée, structurée autour des principes de l’égalité, des droits de l’homme, de la démocratie…).
Aujourd’hui les médias des pays industriels continuent à parler du « Printemps Arabe » de manière à oblitérer les disparités entre des mouvements de contestations populaires de pays différents, car l’amalgame entre les révoltes en Tunisie, en Égypte, au Yémen ou au Bahreïn fausse les singularités de chaque révolte et, par la même occasion, isole la contestation dans les pays arabes du phénomène de la contestation générale contre les méfaits de la libéralisation globale de l’économie. Je pense que les « Indignados » de l’Espagne, les « Occupy Wall Street » des États-Unis, les « Révolutionnaires » de la Place Tahrir au Caire et les manifestants du Bahreïn, veulent tous la même chose : «Bread and Roses» (James Oppenheim).
La fin de la Guerre Froide a ouvert un espace de contestation globale où les luttes des classes s’expriment de manière inédite. Depuis le 11 Septembre, les Musulmans du monde sont redéfinis, par la propagande des puissances industrielles (y compris la Chine), comme la nouvelle icône du mal. Cette stigmatisation ajoute une dimension religieuse « islamique » au clivage social global. Lorsqu’on réalise que les Musulmans représentent plus d’un milliard de la population mondiale, on peut se rendre compte de la gravité d’une telle stigmatisation. Imaginez une force du mal qui s’étendrait sur une superficie allant du Sénégal à la Chine et de l’Ouzbékistan à la Somalie !
Le « monde musulman », dans la bouche des responsable de l’OTAN, est un terme qui renvoie à une intention déclarée de partage du monde entre les grandes puissances industrielles. Dans cette analyse, les Musulmans qui ne sont pas définis comme « modérés » sont une cible à éliminer car, dans une perspective à long terme, ils gênent l’intégration de leurs populations à l’ordre global du capital et, dans une perspective à court terme, ils entravent le pillage des ressources de leurs pays par les puissances industrielles.
Dans cette vision géopolitique, l’art pourrait devenir un enjeu de taille. Cependant, lorsque l’on observe la réaction du monde de l’art, dans les sociétés industrielles, on est surpris par le manque de perspective globale par rapport aux nouveaux horizons qui s’ouvrent devant les créateurs contemporains. Le monde de l’art n’a proposé, jusqu’à maintenant, que des perspectives ethniques qui renvoient à l’état du monde au 19e siècle. Un artiste contemporain qui vient du monde extra-européen ne dispose que d’une contre-catégorie qui le renvoie à sa condition ethnique comme Chinois, Africain ou Musulman.
Une exposition comme Les Magiciens de la Terre (Jean-Hubert Martin, 1989) tentait une réparation morale en proposant une « égalité des cultures » dans laquelle « toute culture est exotique pour l’autre ». Ainsi, la culture des Européens semblait perdre sa position centrale et devenir une des composantes d’un ensemble global. Le problème avec ce concept est qu’il ne vient pas comme le résultat d’une délibération démocratique entre tous, mais comme une proposition des dominants : les Euro‑américains. Que peut un artiste contre les mécènes trop puissants capables de tout, ou presque, sinon contester les fondements moraux de l’ordre de marché ?
AB : Vous critiquez le « regard exoticisant » des Euro‑américains dans le tableau Great American Nude (2002), qui a provoqué de vives réactions lors de l’exposition Africa Remix, car vous y avez « féminisé » Osama Ben Laden en le couchant comme une odalisque. Presque une décennie plus tard, vous êtes revenu à la figure de Ben Laden dans I Love you with my Iphone (2011), ironisant sur La mort de Marat de Jacques‑Louis David. À votre avis, l’image populaire et médiatique de cet homme a‑t‑elle changée suite à sa mort ? Si oui, comment est-ce que vous avez voulu exprimer cette évolution par le glissement de l’odalisque à l’homme politique assassiné ?
HM : Ben Laden n’a jamais été autre chose qu’une image. C’est l’image que les Américains ont choisie, après le 11 septembre, pour incarner les Musulmans. Pendant la Guerre Froide, Al Qaida était l’allié des Américains et Ben Laden avait alors l’image du combattant pour la liberté. Les hommes réels meurent normalement et se font enterrer, mais les icônes peuvent ressusciter si leurs fabricants le décident. Ben Laden, en tant qu’image, ne mourra jamais parce que c’est, désormais, un levier médiatique fabriqué par la machine politique américaine, tout comme Marilyn Monroe, Che Guevara ou le drapeau américain. En fonction de l’attention qu’elle polarise, une image dégage une énergie politique relative à son poids médiatique. J’ai tenté de profiter de l’énergie de l’icône Ben Laden. À chaque fois que la machine américaine des images réactive l’icône Ben Laden, cela m’offre une nouvelle opportunité de jouer avec ce raccourci extraordinaire de la géopolitique des images.
AB : La femme occupe une place de choix dans votre œuvre, que ce soit à travers la légende biblique et littéraire (Suzanne, Shéhérazade, ou même Saint Sébastien Femina), les icônes célèbres comme Joséphine Baker et Saartjes Baartman, ou votre propre grand‑mère, qui figure dans votre texte « i comme identité[5] » décrivant la situation postcoloniale. Dans chaque cas, vous illustrez la détermination de la femme face aux discriminations. Quel est votre positionnement vis‑à‑vis du féminisme ? Êtes‑vous féministe ?
HM : Je suis l’enfant de ma mère, le frère de mes sœurs, le mari de ma femme et le père de ma fille. Toutes ces figures féminines tiennent une place centrale dans mon existence. J’ai conscience qu’il m’est impossible de prendre une distance de neutralité rationnelle pour définir une position critique de cette catégorie politique que nous appelons « le féminisme ». Cependant, quand je regarde mon implication personnelle dans la situation sociale, je ne peux pas dire que je ne suis pas féministe.
AB : Qui serait votre public « idéal » ?
HM : Je pense que la nature du public est une question de classe sociale et de références morales partagées entre l’artiste et le public. L’humoriste français Pierre Desproges disait : « On peut rire de tout mais pas avec tout le monde ». Je pense que tout public est « idéal » du moment que le créateur sait à qui il a à faire. Quand j’enseignais l’art à des adolescents au collège, j’avais souvent un public hostile et sans complexe à l’égard de la culture artistique contemporaine. Cependant, ma connaissance de ce public m’aidait à mieux organiser la « négociation » pour faire saisir la portée d’une œuvre « difficile » à mes jeunes élèves.
AB : Autrefois, vous étiez fasciné par le « blanchissement » progressif de Michael Jackson. Que pensez-vous de sa disparition prématurée ? Marque-t-elle la fin d’une ère ? Sinon, qu’est-ce que ce triste événement représente pour vous en tant qu’artiste ?
HM : Je regrette beaucoup la disparition de Michael Jackson, d’abord parce qu’il fait partie des souvenirs de mon adolescence (The Jackson Five). Ensuite, au‑delà de son immense talent de musicien, je pense que c’est un grand créateur d’images. C’est une image qui se confond avec son créateur. Notre mémoire des images est marquée par l’empreinte de la civilisation judéo‑chrétienne de telle façon qu’aujourd’hui on ne peut rien comprendre à l’histoire de l’art si on n’a pas lu la Bible. Mais une lecture de la Bible est-elle possible sans l’appui des images du sacré, inventées par les artistes chrétiens ? Depuis Michel‑Ange, Dieu siège sur le plafond de la Chapelle Sixtine au Vatican, David est à l’Académie de Florence, tandis que Moïse est à l’église Saint-Pierre aux Liens, à Rome.
L’art a hérité de la tradition des « images pieuses », qui tiennent fonction d’objet de dévotion et de support à la foi. Aujourd’hui, l’enseignement religieux se fait dans les écoles d’éducation artistique tout comme, autrefois, le catéchisme s’enseignait dans les écoles religieuses. Les images de l’art sont devenues des images sacrées. Les pèlerins de toutes confessions, ou sans confession, voyagent aux quatre coins du monde pour rendre hommage aux icones de l’art. Ces images semblent être le dernier refuge du sacré dans un monde moderne qui ne croit plus à rien, ou presque. Aujourd’hui, les musées sont plus peuplés que les églises. Dans ce contexte, Michael Jackson est arrivé comme une sorte de prophète des temps modernes. Son temple ? C’est le lieu des concerts. Son message ? C’est le show. Son miracle ? C’est la métamorphose de son image. Ce prophète caméléon s’adressait à une nation américaine malade d’une ségrégation stupide qui oppose les gens en fonction de la couleur de la peau. Il disait : la loi de la ségrégation est nulle. La frontière de la couleur est une illusion, même si cela est écrit dans la Bible !
En traversant la frontière de la couleur, Michael Jackson perturbe un ordre symbolique bien établi. Cet ordre symbolique est le socle sur lequel l’ordre politique nord‑américain est construit. Michael Jackson est un nouveau Moïse qui frappe la mer des préjugés et sépare les eaux afin que les Américains puissent choisir un Barack Obama comme Président !
AB : Dans un entretien avec Jeune Afrique en 2012, vous avez soutenu que « la lutte sociale n’est pas envisageable en dehors d’une vision religieuse, comme en témoigne l’efficacité des icônes anti‑impérialistes. C’est malheureux, mais le discours de la complexité est rarement audible.[6] » Est‑ce que tout discours simpliste comporte donc un élément religieux à vos yeux ?
HM : La pensée religieuse est efficace parce qu’elle est construite selon la logique du pictogramme : le bien et le mal, rien d’autre ! L’efficacité d’un pictogramme tient à son extrême simplicité. L’argument religieux qui oppose le mal et le bien s’appuie sur la logique de l’impossibilité de choisir le mal.
L’homme est obligatoirement bon. Il ne peut que choisir le bien. Et même quand il s’égare du bon chemin, il pourra laver sa faute par le repentir. Le problème avec les croyants engagés dans un conflit politique, c’est qu’ils sont capables d’entraîner tous les autres dans une destruction totale parce qu’ils ont l’intime conviction que Dieu est avec eux.
AB : En parallèle, vous dénoncez tout aussi fermement le « culte » du marché de l’art qui fait grimper les prix en fonction de la célébrité. Il faut pourtant que l’artiste puisse vivre. Que doit‑on substituer à cette logique mercantile ?
HM : En tant qu’utopiste désespéré, je souhaite que l’art, comme l’éducation, la santé et la justice, ne soit pas dans le marché. Un jour où : « Le loup résidera avec le mouton, le léopard s’accroupira avec le chevreau; le veau, le lionceau, le buffle, ensemble, un petit adolescent les conduira » (Isaïe 11:6). En attendant ce jour, je ne peux que continuer à opposer, aux images du marché, mes images qui portent ma critique face aux aberrations de la société marchande. Je sais que, dans une seule vie, je ne peux pas changer le monde, mais je ne laisserai pas le monde changer ma vie sans rien faire.
Footnotes
- Hassan Musa, « Je pars d’un principe très simple : les gens sont intelligents, » entretien avec Lucie Touya et Thierry William Koudedji, Africultures. Alex Marise Bique (dir.). 4 Nov. 2005. Internet. 3 Jan. 2014.
- Voir notamment « Le droit‑fil de la couture, » Renaud Faroux dans Art absolument, 40 (mars‑avril 2011) 75, ainsi que « Le fabuleux butin de Hassan Musa, » Nicolas Michel, in Jeune Afrique, 2686 (1‑7 Juillet 2012) 96.
- Les références au tableau « Les Glaneuses » (1857) de Jean-François Millet sont multiples dans l’œuvre de Hassan Musa. Voir notamment L’art du déminage (2004), The good pain (2007) et The total hapiness (2008).
- Hassan Musa, « Je pars d’un principe très simple : les gens sont intelligents. »
- Hassan Musa, « i comme identité » dans Musa, Catalogue de l’exposition Icônes, Galerie NKA, Bruxelles, 2006, 24-25.
- Nicolas Michel, « Soudan : Le fabuleux butin de Hassan Musa », 98.