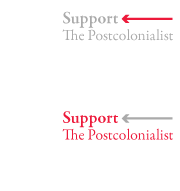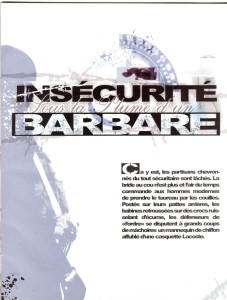Abstract
Cet article entend interroger le tournant postcolonial opéré par le rap français depuis le début des années 2000. Il s’agira de montrer en quoi l’émergence d’un rap français structuré autour de la critique postcoloniale a marqué une rupture par rapport aux premiers enregistrements de rap français dans les années 1990 et dans quelle mesure ce tournant s’inscrivait dans le contexte de l’époque. C’est parce que le fait postcolonial s’est progressivement imposé dans les années 2000 que la critique postcoloniale a percé dans le rap français. Dans le même temps, certains rappeurs ont été des acteurs de premier plan qui ont contribué, avec d’autres, à la mue postcoloniale de la société française. En retour, la critique postcoloniale est devenue une cible privilégiée et on a assisté à une criminalisation de cette dernière. Mais en cherchant à étouffer les voix dissonantes, le pouvoir politique a affirmé sa propre colonialité qu’il entendait pourtant réfuter.
Mots clés : rap, postcolonialisme, répression, minorités, identité, race/racisme/ethnicité
Cet article se propose d’interroger le tournant postcolonial opéré par le rap français dans les années 2000 en s’intéressant à la fois à l’émergence d’une critique postcoloniale dans cette musique et à sa répression. Je souhaite montrer que depuis le procès intenté à Hamé du groupe La Rumeur, les attaques portées contre le rap sont de nature différente de celles traditionnellement portées contre cette musique dans les années 1990. Si le rap était autrefois critiqué pour sa violence, c’est désormais la critique postcoloniale – requalifiée alors en « discours anti-Français » ou « anti-Blancs » – qui est directement visée. La prise de conscience du fait postcolonial a longtemps été retardée par la prétention à l’universalisme du modèle républicain français. Alors que les postcolonial studies forment un champ d’études universitaires depuis une trentaine d’années aux Etats-Unis, le chantier n’a été ouvert que très récemment en France. Il a fallu attendre le début des années 2000 et le « retour des mémoires coloniales » pour que la France effectue sa difficile mue postcoloniale, non sans y opposer une forte résistance (Cohen et al. 2007)[1].
En France, un certain nombre de rappeurs contribuèrent au tournant postcolonial de la France et de son rap. Parmi ces artistes, qui émergent dans les années 2000, se trouvent La Rumeur, qui le premier qualifia sa musique de « rap de fils d’immigré »[2], Casey, Rocé, La Caution ou encore Médine. Les identités plurielles postcoloniales énoncées dans le rap visent, comme l’explique Casey, à faire émerger « le point de vue des damnés des colonies »[3] et à démontrer l’hypocrisie de l’universalisme abstrait de la république qui masque en réalité son ethnocentrisme et, plus encore, sa colonialité[4]. Les « politiques de la ville » contemporaines – euphémisme désignant le traitement spécifique réservé aux banlieues – sont ainsi vécues par les populations ciblées, souvent originaires des anciennes colonies françaises, comme la continuité des politiques coloniales d’hier. Deux ans après les émeutes urbaines de 2005, Ekoué du groupe La Rumeur revenait sur les évènements et donnait voix à un sentiment partagé en pointant que « tout porte à croire que les tiers-quar [quartiers] ont toute la France contre eux »[5]. Puisque de nombreux rappeurs ont grandi dans ces quartiers et/ou sont « fils d’immigrés », ils sont identifiés par les pouvoirs publics et les médias comme les « porte-paroles » de la jeunesse postcoloniale des quartiers (Prévos 1998 : 67-69 ; Béru 2006 : 62-63). C’est à ce titre qu’un certain nombre d’entre eux furent conviés à venir s’exprimer sur les plateaux télévisés lors des émeutes de 2005[6]. Ceux qui refusaient de se plier aux injonctions à la responsabilité furent accusés par des personnalités de droite d’être « hardcore » et de propager un discours haineux « anti-Français ». Comme le notait le journal Le Monde, le rap fut dès lors mis « à l’index » (Le Monde 2005).
C’est parce que le fait postcolonial s’est imposé en France que la critique postcoloniale a trouvé sa place dans le rap françaises mais, dans le même temps, les rappeurs ont été des acteurs de premier plan qui ont contribué, avec d’autres, à ce tournant postcolonial. Dans un premier temps, j’explorerai une généalogie de l’émergence de la critique postcoloniale dans le rap pour en montrer la spécificité. Si les thèmes du rap postcolonial des années 2000 ne sont pas inédits, ils sont énoncés en des termes qui, eux, sont majoritairement absents du discours public. Dans un deuxième temps, je reviendrai sur la répression du rap depuis le procès intenté à Hamé. Je souhaite montrer que l’acharnement du pouvoir contre la critique postcoloniale dans le rap ne fait que donner de la force à cette dernière. Car en poursuivant les groupes de rap « postcoloniaux », le pouvoir affirme sa propre colonialité qu’il entendait pourtant réfuter.
I. Le tournant postcolonial du rap français
Le rap français a-t-il toujours été postcolonial ?
La plupart des universitaires écrivant sur le rap français s’accordent sur la dimension identitaire postcoloniale de cette musique sans pour autant distinguer suffisamment entre les différentes périodes (Prévos 2002 ; Béru 2006). J’affirme pour ma part que cette dimension postcoloniale n’est réellement devenue structurante que dans les années 2000. Cela ne veut pas dire que l’on ne trouve pas de commentaires sur la colonisation, l’esclavage ou l’immigration dans le rap des années 1990 – et notamment chez IAM, le Suprême NTM ou encore le Ministère A.M.E.R., les trois principaux groupes français des débuts[7] du genre – mais plutôt que la perspective adoptée diffère de ce que l’on observe à partir des années 2000.
Nombreux sont les rappeurs qui, dans les années 1990, ont traité dans leurs chansons du harcèlement policier contre les jeunes des quartiers populaires ou de la colonisation notamment. Prenons le Suprême NTM par exemple. Dans « Plus jamais ça », Kool Shen rappe :
- Les honneurs, la patrie, les conquêtes et les colonies
- On a déjà vu le résultat de ces conneries
- Alors va-t-on continuer à se laisser manœuvrer
- Par la haine d’un déséquilibré mental
- Je vous rappelle qu’il prône la ségrégation raciale
- Je vous rappelle encore que cet homme n’est pas normal
- Et ce depuis la déconvenue de la guerre d’Algérie[8]
Il y a ici un commentaire évident du passé colonialiste et impérialiste de la France. Mais cela suffit-il pour faire de « Plus jamais ça » un morceau « postcolonial » ? Le mot d’ordre « plus jamais ça » et la perspective adoptée tranchent avec le rap postcolonial des années 2000. Pour les groupes postcoloniaux, « tout brûle déjà », comme l’affirme La Rumeur qui titre ainsi son dernier album. Alors que la plupart des groupes des années 1990 commentent le passé colonialiste de la France, les groupes postcoloniaux des années 2000 vont plus loin en établissant un continuum entre le passé colonialiste de la France et l’actuelle colonialité du pouvoir. À la différence de ce qu’on observe chez Casey ou La Rumeur notamment, la perspective dans « Plus jamais ça » n’est que peu phénoménologique. Kool Shen décrit des faits plus qu’une condition qui lui serait propre[9]. Il poursuit d’ailleurs :
- Mais nous on s’en bat les couilles, on n’était pas là
- Et on est tous las de ce retour au même schéma[10]
C’est là une différence majeure avec les rappeurs postcoloniaux des années 2000 qui considèrent que leur condition postcoloniale, directement héritée du colonialisme, est inscrite en eux, gravée à même leur corps. Ils n’étaient peut-être « pas là » mais ces évènements, dans leur actualité, continuent de surdéterminer leur existence, qu’il s’agisse des opportunités d’accès à l’emploi ou au logement ou même, plus directement, de leur personnalité.
Dans « Tragédie d’une trajectoire », morceau qui n’est pas sans rappeler les pages autobiographiques de Fanon dans Peau noire, masques blancs, Casey décrit sa propre expérience vécue et les conséquences psychologiques de sa condition subalterne :
- Tout ça n’a pas de sens, mais tout ça laisse des traces
- Et je ne dis rien à ma mère le soir quand elle m’embrasse[11]
La tragédie de Casey, c’est de ne pas maîtriser sa trajectoire parce que surdéterminée par sa condition minoritaire. Dans le premier couplet, cette impuissance est énoncée par une série de questions : « Pourquoi suis-je si radicale ? » ; « pourquoi suis-je si marginale ? » et « pourquoi être stable dans ma tête est impossible ? » Il ne fait pas de doute ici que Casey décrit sa propre expérience vécue ; bien que l’esclavage et la colonisation soient derrière elle, « tout ça laisse des traces ». C’est cette dimension phénoménologique qui est largement absente des premiers enregistrements du rap français, même si les prémisses d’une critique postcoloniale se font entendre. Les groupes des années 1990, s’ils abordent parfois la colonisation, l’immigration et l’esclavage, n’en font cependant pas des éléments déterminants de leur identité comme le feront les groupes de rap qui émergent dans les années 2000.
Il me semble que l’on peut avancer trois hypothèses pour expliquer cette différence générationnelle. Tout d’abord, le rap français était une musique dont l’imaginaire était encore largement américain. Or, ainsi que le note Laurent Béru, le rap est, aux États-Unis, un art post-ségrégation plus que postcolonial. Il a fallu que le rap français s’émancipe de ses influences pour devenir postcolonial, ainsi que le supposait le contexte français. Ensuite, c’est la construction médiatique du rap comme « expression des banlieues et des minorités » qui va amener les rappeurs, à partir des années 1990, à revendiquer un message directement politique sur la banlieue et les minorités raciales et ethniques. Tout à la fois rejetés et fétichisés, les rappeurs accèdent à une forme de médiatisation ambivalente et sont érigés en porte-paroles de la jeunesse urbaine postcoloniale. Dès lors, leur parole sur la banlieue est paradoxalement légitimée. Karim Hammou observe que « l’assignation médiatique du rap aux banlieues et l’ancrage du hip-hop dans les quartiers de la politique de la ville interagissent ainsi avec l’expérience sociale d’une frange de la jeunesse, dans un contexte de paupérisation des quartiers populaires, de ségrégation spatiale accrue et de tournant répressif dans la gestion des illégalismes populaires. Ils contribuent à légitimer l’élaboration musicale de formes d’écriture, de points de vue et de thèmes nouveaux » (Hammou 2012, 141). Par ce statut nouveau conféré par leur médiatisation soudaine, les rappeurs ont désormais un accès à la parole publique, et une injonction à l’expression d’un point de vue politique sur la banlieue. D’abord ludique, le rap devient politique. Comme l’affirme Mathieu Marquet dans son article sur la politisation de la parole rap, « c’est le fait même de pouvoir dire qui mène vers une envie de dire, et partant, à l’expression du et d’un point de vue politique » (Marquet 2013). Cette envie de dire va progressivement prendre la forme d’un discours postcolonial. Progressivement, car pour que le rap devienne postcolonial, encore fallait-il que le fait postcolonial se soit imposé en France. Cela ne s’est fait qu’au cours des années 2000 alors qu’il était largement ignoré ou minoré avant cela (Smouts 2010). C’est donc la troisième hypothèse que je formule : le contexte était davantage propice dans les années 2000[12]. Cela étant dit, je n’affirme pas, loin de là, que les groupes « postcoloniaux » n’ont fait que s’engouffrer dans la brèche. Au contraire, je pense que la France a effectué sa difficile mue postcoloniale en partie grâce au rap qui, dans le même temps, s’est nourri de la critique postcoloniale et de sa « bibliothèque […] en pleine expansion » (Cohen et al. 2007). Certains rappeurs ont donc été des acteurs qui ont introduit la critique postcoloniale en France, même s’ils ne l’ont bien évidemment pas fait seuls[13].
L’expérience vécue de la condition minoritaire comme fondement de la critique postcoloniale
Dans un article traitant des liens entre la critique postcoloniale et la critique de classe dans le rap français, Marie Sonnette affirme que la critique postcoloniale passe par des modes d’énonciation spécifiques, et notamment par la constitution d’un sujet collectif, un « nous » postcolonial. Pour autant, « derrière les “nous” englobant les minorités issues de la colonisation viennent s’apposer des réalités différentes selon les rappeurs et les morceaux » (Sonnette 2014 :168). Il me paraît nécessaire de préciser ici que cet article ne prétend pas à l’exhaustivité en ce qui concerne la critique postcoloniale dans le rap français. Plutôt, il va s’agir d’étudier quelques groupes et artistes considérés comme représentatifs de la critique postcoloniale ou ayant joué un rôle actif dans le tournant postcolonial de la société française (La Rumeur, Casey, La Caution et Rocé, principalement). Au-delà des différences qui existent entre les rappeurs et groupes étudiés, la critique formulée par les groupes de rap postcoloniaux témoigne d’une prise de conscience de la part des minorités dites « issues de l’immigration » d’inégalités structurelles de représentations culturelles et politiques et de discriminations systémiques à leur égard. Si les rappeurs ont publicisé (et ainsi politisé) les discriminations qui s’exerçaient à leur encontre, ils ont également revendiqué une identité culturelle partagée autour du souvenir de l’esclavage, de la colonisation, de l’immigration et des articulations entre ces trois mémoires. Pour nombre de jeunes dits « issus de l’immigration », seule la culture populaire, et en premier lieu le rap, est à même d’offrir des représentations susceptibles d’être réappropriées. A l’inverse, l’école, en tant qu’appareil idéologique d’État[14], est souvent un passage obligé dans l’apprentissage de la colonialité du pouvoir pour les élèves originaires des anciennes colonies. Dans un entretien, Hamé évoque le sentiment d’humiliation qu’il a souvent ressenti à l’école, depuis le « nos ancêtres les gaulois » jusqu’à l’enseignement de la colonisation et de la guerre d’Algérie (Tévanian 2012). Chez nombre de rappeurs, il s’agit là d’un trauma fondateur qui va nourrir leur critique postcoloniale et qu’ils vont mettre en scène dans leurs chansons. Casey se remémore ainsi ses années collège et le racisme de l’institution à son encontre :
- Au collège, ils me connaissent, se plaignent et ils gémissent
- La proviseure est une connasse qui me vire et me menace
- D’appeler la police pour ma sale tignasse
- Et les profs me provoquent, chaque jour me convoquent
- Et me disent qu’on me scolarise pour les allocs.
- Donc je réplique, moi l’enfant de la république
- Et on me rétorque que tout c’que j’mérite c’est des claques[15].
Dans « Le cartable renversé », paru sur l’album L’être humain et le réverbère, Rocé passe en revue un certain nombre des situations où se joue l’apprentissage des rapports de pouvoir, comme lorsqu’un enfant d’immigrés est pris pour cible par une institutrice :
- Jusqu’à ce jour la voix d’sa mère l’avait bercé
- Sur les bienfaits d’être droit envers l’autorité
- Loin des p’tits cons d’en bas que les emmerdes ont cerné
- En réponse au trama, son cartable renversé[16]

Image 1. La Caution, Peines de Maures/Arc-en-ciel pour daltoniens
Cet apprentissage du racisme et de la condition minoritaire est également évoqué par Nikkfurie, du groupe La Caution, dans « Thé à la menthe » : « Jeune, j’ai l’souvenir d’une « Madame Nicole » / Instit’ qui pensait qu’un bougnoule n’était pas fait pour l’école »[17]. Dans la phénoménologie de la domination mise en scène dans les paroles rap, l’école constitue le lieu premier de la prise de conscience du racisme. D’où la pochette de l’album Peines de Maures / Arc-en-ciel pour daltoniens (image 1) qui représente les deux rappeurs enfants, comme pour montrer que, « pourtant jeunes et innocents »[18], c’est bien à cette époque qu’ils ont pris conscience de leur condition postcoloniale. Bien que nés en France, les rappeurs ne sont pas perçus comme « Français » à part entière puisque « ce pays [la France] est presque le [leur] / Mais seulement presque »[19]. Ne pouvant être simplement Français, c’est dans la réappropriation du stigmate « indigène » ou « issu de l’immigration » que se joue la subjectivation des identités plurielles. Cette stratégie de la réappropriation du stigmate est explicite chez Rocé :
- Il y a un vécu à défendre
- Il y a une vision à répandre
- Et de nous vers eux
- Il y a une étiquette à leur rendre[20]
Pour les groupes et artistes qui portent la critique postcoloniale, le point de départ de leur « trajectoire » (Casey), de leur « identité en crescendo » (Rocé), de leurs « peines de Maures » (La Caution), c’est l’immigration et le souvenir de la colonisation, ainsi que le clame La Rumeur : « C’est une valise dans un coin / qui hurle au destin qu’elle n’est pas venue en vain »[21]. Le rap postcolonial semble avoir fait siennes les leçons de Benjamin dans ses « Thèses sur le concept d’histoire », et plus particulièrement celle-ci :
« Il existe un rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre. Nous avons été attendus sur la terre. À nous, comme à chaque génération précédente, fut accordée une faible force messianique sur laquelle le passé fait valoir une prétention » (Benjamin 2000 : 428-429)
C’est donc dans l’appropriation du passé que le présent peut s’éclairer. Sans cela, « même les morts ne seront pas en sûreté » (Benjamin 2000 : 431). Et il suffit pour s’en convaincre de se remémorer les débats de 2005, année décidemment charnière, ayant mené à l’adoption d’une loi faisant valoir un prétendu « rôle positif » de la colonisation[22].
II. Le rap postcolonial exposé, la colonialité du pouvoir démasquée
« Qui sont vos frères ? » : retour sur le procès intenté à Hamé
Depuis ses débuts en France, le rap a toujours été exposé médiatiquement, condamné moralement et poursuivi judiciairement par les représentants des forces de police ou par des politiques (Prévos 1998). Comme cela s’est produit aux Etats-Unis, le rap en France a très tôt été condamné par la classe politique pour la « violence » de ses paroles[23]. Mais alors que le fait postcolonial prend de l’importance dans les années 2000 et que l’écran de l’universalisme abstrait se fissure, le rap est alors dénoncé pour toute autre chose. Désormais, ce sont la critique postcoloniale et la francité même des artistes qui sont dans le viseur des hommes politiques. Initiateur de ce changement est le procès intenté à Hamé par le ministère de l’intérieur.
En 2002, Hamé écrit dans le fanzine du groupe publié à l’occasion de la sortie du premier album un pamphlet intitulé « Insécurité sous la plume d’un barbare ». Dans ce texte, il affirme notamment que « les rapports du ministère de l’intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu’aucun des assassins n’ait été inquiété » (Hamé 2010). Un constat qu’illustre tristement la relaxe, après dix ans de procédure judiciaire, des deux policiers poursuivis pour non-assistance à personne en danger suite à la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré en 2005[24]. À l’époque, celui qui n’était encore que ministre de l’intérieur, Nicolas Sarkozy, porte plainte contre le groupe pour « diffamation publique envers la police nationale » [25]. Le procès va durer huit ans, ce qui est assez exceptionnel pour une affaire de ce type : trois relaxes, deux jugements en appel et deux pourvois en cassation. Aucune condamnation donc, malgré l’acharnement du ministère de l’intérieur[26]. Alors qu’Hamé aurait pu se retrancher derrière la liberté d’expression, il a choisi de porter le procès sur le plan politique, souhaitant « ouvrir publiquement et politiser un débat jusqu’ici confiné dans la sphère de la recherche universitaire » (Monteiro 2008). C’est la colonialité du pouvoir qu’Hamé souhaitait mettre en accusation devant les tribunaux, comme aucun rappeur avant lui. C’est pourquoi Hamé s’est entouré d’experts –historiens, sociologues, enseignants, activistes etc. –, « en mesure de corroborer et d’étayer [ses] propos » (Acontresens 2007).
En amont du procès, l’avocat du rappeur explicitait lui aussi cette ligne de défense en faisant valoir que les témoins-experts allaient l’aider à prouver que « les humiliations policières à répétition font bien partie du quotidien pour un certain nombre de ces jeunes » (Monteiro 2008). La question étant de savoir quels jeunes et sur quels critères : « qui appelez-vous vos “frères”, qui semblent se faire trucider en toute impunité ? » demanda ainsi la juge rapporteur durant le procès (Acontresens 2006). Par son agacement, qui transparaît dans la formulation même de la question, la juge rapporteur sommait Hamé de s’expliquer sur ce qu’elle considérait comme un crime de lèse-majesté contre l’universalisme républicain, son supposé communautarisme. Hamé répondit que « frère » était un « terme usuel » qui revêtait une « charge affective » et désignait une « fratrie avec laquelle on peut se trouver des cicatrices et des espoirs communs » (Acontresens 2006). Pas d’essentialisme ni de communautarisme chez Hamé donc, mais plutôt une politique de la coalition[27]. Les frères d’Hamé sont tous les individus qui se reconnaîtront des cicatrices et des espoirs communs. Toutes ces cicatrices qu’ « on [leur] a demandé d’oublier », comme ce « 17 Octobre 61 qui croupit au fond de la Seine »[28]. Et au-delà, ces espoirs, cette « saleté d’espérance » comme la nomme Rocé[29].
Après huit ans de procès, Hamé sera définitivement acquitté en juin 2010. Plus qu’une histoire de personne, ce procès a été important en cela qu’il a finalement contraint le pouvoir à révéler sa colonialité puisque, ainsi que l’avait noté Hamé, « en nous intentant ce procès on nous signifie qu’on n’est pas autorisé à s’exprimer sur le plan politique » (Monteiro 2008). Récemment, Ekoué et Le Bavar, de La Rumeur, affirmaient dans un entretien ne rien regretter quant à leur engagement politique et postcolonial, allant jusqu’à dire que le procès qui leur avait été intenté « fait partie de l’histoire de La Rumeur ». Et Ekoué de poursuivre : « on va fêter les 10 ans des émeutes [et] les mecs qui ont fumé Zyed et Bouna, ils sont toujours pas au placard » (Lebonson 2015).
Contraindre au silence les voix dissonantes
Depuis le procès intenté à Hamé et plus encore depuis les émeutes urbaines de 2005, le rap postcolonial est une cible privilégiée des politiques. La plus récente des attaques, toujours en cours au moment où j’écris ces lignes et connue sous le nom de l’ « affaire “Nique la France” », a vu Saïdou du groupe ZEP (« Zone d’Expression Populaire ») être mis en examen pour « injure publique » et « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence » pour un ouvrage co-écrit avec le sociologue Saïd Bouamama (lui aussi mis en examen) qui reprenait le titre d’une de ses chansons, « Nique la France ». Un groupe de députés UMP, parmi lesquels Christian Vanneste, celui-là même qui avait fait inscrire l’expression « rôle positif » dans la loi sur la « présence française outre-mer », avait soumis une question écrite au Ministre de la Culture et de la Communication. Je cite ici un passage éclairant, dans lequel ces députés s’interrogent :
« [Est-ce qu’il] apparaîtrait opportun [à Saïd Bouamama, sociologue algérien résidant en France] que des écrivains français publient, à titre d’exemple en Algérie, un ouvrage s’inspirant avec délicatesse du titre choisi par Saïd Bouamama mais intitulé, cette fois, “Nique l’Algérie” ? »
Ces députés semblaient ignorer dans un premier temps que le titre de l’ouvrage ne doit pas tant à Saïd Bouamama qu’au rappeur Saïdou. Mais la question était malgré tout intéressante par ce qu’elle révélait : en admettant que l’on ait le droit d’affirmer de manière provocatrice qu’on « nique la France », qui donc peut se permettre de tenir ce discours ?
Pour les députés, il était évident que même en acceptant que de tels propos puissent être tenus, ils ne pouvaient absolument pas l’être par un « non-national ». Mais plus que cela, il semblait bien qu’étaient visés tous les français « d’origine ». D’ailleurs, lorsque l’AGRIF (« Association Générale contre le Racisme et pour le Respect de l’Identité française et Chrétienne »), association d’extrême droite catholique, porta plainte contre les co-auteurs, elle ne manqua pas de signifier qu’elle traquait en réalité un prétendu « racisme anti-Français ». Et tant pis si Saïdou est lui-même Français. Plus ironique encore, la chanson qui a donné son titre à l’ouvrage n’est pas chantée par Saïdou lui-même. Ce sont des Français, directement identifiés par l’AGRIF et consorts comme tels car « Blancs », qui rappent sur un air de musette :
- « Nique la France, et son passé colonialiste
- Ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes »[30].
Cette subtilité a visiblement échappé aux différents acteurs dans cette affaire puisque seuls Saïdou et Saïd Bouamama furent poursuivis.
Mais en cherchant à étouffer certaines voix dissonantes par la censure, le pouvoir politique révèle les différents degrés de citoyenneté, selon que l’on soit du bon ou du mauvais côté de la « frontière raciale », faisant ainsi la preuve de ce qu’il cherche à taire. Saïdou notait en 2009 :
« Quand tu prends position [sur le « privilège racial blanc en France »] on va te définir comme un arabe issu de l’immigration, pas comme un intellectuel ou un artiste. Alors que si Blanchard [historien – blanc – spécialiste de l’immigration] dit la même chose, tout le monde va dire “Oui, effectivement, c’est indéniable” » (Tévanian 2009).
Soit une illustration de la citoyenneté à deux niveaux dénoncée par la critique postcoloniale. Malgré tout, même si la judiciarisation du rap postcolonial expose au grand jour la colonialité du pouvoir, il n’en demeure pas moins que ce sont autant d’interdictions de se produire sur scène, de censure et de procédures coûteuses qui s’appliquent sur ceux et celles qui dénoncent non seulement le passé colonialiste de la France, mais aussi son actuelle colonialité.
Conclusion
Dans cet article, j’ai souhaité retracer l’émergence de la critique postcoloniale dans le rap français en montrant à la fois que cette dernière n’a été rendue possible que par un ensemble de facteurs convergents mais aussi qu’elle a contribué, à son niveau, à la mue postcoloniale de la société française. Si une certaine dimension critique quant au passé colonialiste de la France et à son racisme structurel existait déjà dans les premiers albums de rap français, il était encore trop tôt pour parler de rap français postcolonial. C’est la polarisation de la société française autour des débats sur le fait postcolonial qui a rendu possible l’émergence d’une critique postcoloniale dans le rap français. Ainsi, ce n’est réellement qu’à partir des années 2000 qu’un certain nombre d’acteurs vont politiser leur condition minoritaire, plurielle et postcoloniale et dénoncer dans leur parole la continuité des pratiques coloniales qui s’appliquent à leur encontre, ce qui leur vaudra de s’attirer les foudres des sphères politiques et médiatiques. Loin d’être une politique isolée, ces attaques portées contre le rap – et plus encore contre les rappeurs et rappeuses – sont à ranger aux côtés des nombreux débats sur la laïcité (en réalité, sur l’islam), le rôle prétendument positif de la colonisation ou encore le caractère supposé « non intégrable » de certaines populations « issues de l’immigration » ou « de confession musulmane ». La condamnation morale du rap et son exposition judiciaire s’insèrent ainsi dans un dispositif de pouvoir plus large que l’on peut appeler racisme structurel ou colonialité du pouvoir.
Constamment ramenés à leur condition minoritaire, les rappeurs vont entreprendre une politique de réappropriation du stigmate en énonçant des identités culturelles articulées autour de la mémoire de l’esclavage, de la colonisation et de l’immigration. Soient des constructions hybrides, provisoires et mouvantes qui revendiquent un « droit à la différence dans l’égalité » (Balibar, 1997). Leur identité postcoloniale étant la raison de leur assujettissement, ils font de sa reconnaissance une condition sine qua non au vivre ensemble en France. C’est ce qu’exprime Rocé lorsqu’il affirme qu’il chantera la France lorsqu’elle le reconnaîtra « comme être multiple » (Rocé, « Je chante la France », 2006).
Footnotes
- Contrairement à ce que le préfixe « post » pourrait laisser entendre, « postcolonial » ne désigne pas tant « l’après-colonialisme » (« le colonialisme est mort ») que la poursuite des politiques colonialistes par d’autres moyens (« le colonialisme est mort, vive le postcolonialisme »). C’est la survivance de la condition coloniale qui est au centre du fait postcolonial.
- Une qualification que l’on retrouve dès 1999 dans le morceau solo d’Ekoué « La petite rime assassine » par exemple. La Rumeur (2007), 1997-2007 : Les inédits.
- Casey (2006), « Dans nos histoires », Tragédie d’une trajectoire.
- Le concept de colonialité du pouvoir, forgé par le sociologue péruvien Annibal Quijano, renvoie au décalage entre les affirmations formelles d’égalité inscrites dans la loi et les discriminations systémiques sur la base de la race ou de l’ethnicité. La matrice coloniale du pouvoir a pour effet de produire différents niveaux de citoyenneté selon le partage des frontières raciales (Quijano dans Cohen et al. 2007 : 111-118).
- La Rumeur (2007), « Qui ça étonne encore ? », Du cœur à l’outrage.
- Avec une polarisation entre les rappeurs « responsables » et consensuels comme Disiz La Peste et ceux comme La Rumeur qui soutenaient les émeutiers ou expliquaient leurs actions par les causes profondes qui minent les quartiers. Comme le résume la voix off qui annonce un débat organisé par l’émission Tracks entre Ekoué (La Rumeur), Joey Starr (ex NTM) et Disiz La Peste, les rappeurs étaient « sommés de choisir leur camp » : < http://www.dailymotion.com/video/xhie5_disiz-joey-ekoue > (5 novembre 2013).
- Nous pourrions rajouter à cette liste les X-Men, Ärsenik, Lunatic, etc.
- NTM (1995), « Plus Jamais ça », Paris sous les bombes.
- Cela peut s’expliquer par le fait que Kool Shen, Français d’origine portugaise, n’est pas « issu » d’une ancienne colonie française.
- NTM (1995), « Plus Jamais ça », op. cit.
- Casey (2006), « Tragédie d’une trajectoire », op. cit.
- Cela pourrait d’ailleurs expliquer pourquoi ce n’est qu’à partir de la fin des années 1990 que des rappeurs blancs interrogent ou mettent en avant leur blanchité (Hammou 2013). On peut y voir l’effet du tournant postcolonial opéré par le rap français à cette époque, qui « conduit aussi nombre d’artistes [blancs] à endosser à leur tour une posture artistique signant l’authenticité de leur adresse en situant le lieu racial d’où ils parlent, y compris lorsque ce lieu est celui du groupe majoritaire » (Ibid., p. 194).
- La Rumeur est sans doute le groupe qui a le plus contribué à la mue postcoloniale de la France et de son rap, à la fois par les thèmes développés dans les albums du groupe et par l’engagement associatif et politique de ses membres. La Rumeur est l’un des membres fondateurs des Indigènes de la République, acteur capital bien que controversé de la mue postcoloniale française.
- Althusser définit le pouvoir comme à la fois répressif et idéologique (Althusser 1976). L’idéologie républicaine, transmise à l’école notamment, est un des moyens dont s’est doté l’État pour assurer sa domination.
- Casey (2006), « Tragédie d’une trajectoire », op. cit.
- Rocé (2010), « Le cartable renversé », L’être humain et le réverbère.
- La Caution (2005), « Thé à la menthe », Peines de Maures / Arc-en-ciel Pour Daltoniens.
- Ibid.
- La Caution (2005), « Peines de Maures », op. cit.
- Rocé (2001), « On s’habitue », Top Départ.
- La Rumeur (2002), « Le cuir usé d’une valise », L’ombre sur la mesure.
- Le 23 février 2005, l’Assemblée Nationale adopte une loi qui demande aux programmes scolaires de reconnaître « en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer ».
- Voir par exemple cet article du Monde : « Certains groupes de rap sont accusés d’être trop “violents” », Le Monde, 8 septembre 1995.
- Le 27 octobre 2005, Zyed Benna et Bouna Traoré, poursuivis par la police, s’étaient réfugiés dans un transformateur électrique, où ils avaient trouvé la mort par électrocution. Malgré un message radio pour le moins explicite délivré par l’un des policiers (« en même temps, s’ils rentrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau »), le tribunal correctionnel de Rennes a relaxé les deux policiers, affirmant notamment que « si [le policier] avait eu conscience d’un péril grave et imminent, il n’aurait pas manqué de réagir d’une manière ou d’une autre ». Le délibéré est consultable en ligne < http://fr.scribd.com/doc/265744103/Delibere-proces-Clichy-sous-Bois > (17 juin 2015).
- Le passage suivant était également incriminé : « La réalité est que vivre aujourd’hui dans nos quartiers c’est avoir plus de chance de vivre des situations d’abandon économique, de fragilisation psychologique, de discrimination à l’embauche, de précarité du logement, d’humiliations policières régulières ».
- Un second pourvoi en cassation, particulièrement en matière de presse, est exceptionnel (Blondeau 2008).
- La philosophe Judith Butler propose comme alternative aux politiques identitaires – qui supposent un sujet défini et une identification à ce sujet – une politique de la coalition qui permet l’alliance entre des personnes aux identités multiples. Notons malgré tout que chez La Rumeur – en tout cas par la voix d’Ekoué – cette politique de la coalition trouve ses limites puisque l’identité postcoloniale semble incompatible avec l’identité homosexuelle. Ekoué se distingue régulièrement dans ses morceaux par des sorties homophobes. Visiblement peu à l’aise avec la question, il affirmait dans une interview qu’ « il ne faut pas mettre sur le même plan l’homophobie et le racisme. Faut arrêter les conneries. Le racisme a fait beaucoup plus couler de sang que l’homophobie. Donc, il ne faut pas faire d’amalgame entre les minorités noires et les minorités homosexuelles » (Abcdrduson 2003). En opposant ainsi minorités noires aux minorités homosexuelles, Ekoué essentialise l’identité noire, supposée toujours nécessairement hétérosexuelle.
- La Rumeur, « On m’a demandé d’oublier », Le Franc-Tireur, EMI, 2000. Le 17 Octobre 1961, bravant le couvre feu, la fédération de France du FLN organise une manifestation à Paris qui sera réprimée dans le sang par la police française. L’historien Jean-Luc Einaudi estime que le massacre aurait fait au moins 200 morts. La mémoire de ce massacre sera d’ailleurs convoquée en première instance par Maurice Rajsfus pour appuyer les dires de Hamé.
- Rocé (2005), « Ma saleté d’espérance », Identité en crescendo.
- Z.E.P (2009), « Nique la France ». Le clip est visible à l’adresse suivante : < http://www.dailymotion.com/video/xc08wd_zep-nique-la-france_music > (5 décembre 2012). Un « comité des insolents » a depuis été monté en soutien à Saïdou et Saïd Bouamama et proclame « Contre le racisme, devoir d’insolence » : < http://.devoirdinsolence.fr/ > (5 décembre 2012).
Works Cited
Références
Abcdrduson (2003), « Interview La Rumeur (II) », < http://www.abcdrduson.com/interviews/print.php?id=47 > (11 novembre 2013).
Acontresens (2006), « La Rumeur devant ses juges », < http://www.acontresens.com/contrepoints/societe/29.html > (7 novembre 2013).
Acontresens (2007), « La Rumeur hors de cause/sous tension », < http://www.acontresens.com/musique/interviews/25.html > (7 novembre 2013).
Althusser, Louis (1976), « Idéologie et appareils idéologiques d’État. (Notes pour une recherche) », Positions (1964-1975), Paris, Les Éditions sociales, p. 67-125.
Balibar, Étienne (1997), La crainte des masses – Politique et philosophie avant et après Marx, Paris, Galilée.
Barthes, Roland (1970), Mythologies, Paris, Éditions du Seuil.
Benjamin, Walter (2000), Œuvres III, Paris, Gallimard.
Béru, Laurent (2009), « Le rap français, un produit musical postcolonial ? », Volume ! La revue des musiques populaires, n°6-1.
Bhabha, Homi (2007), Les lieux de la culture – Une théorie postcoloniale, Paris, Payot.Blondeau, Thomas (2008), « La Rumeur, au-delà de l’acharnement », Le Monde Diplomatique, < http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2008-09-30-La-Rumeur > (7 novembre 2013).
Bouteldja, Houria et Khiari, Sadri (2012), Nous sommes les indigènes de la République, Paris, Éditions Amsterdam.
Butler, Judith (2010), Ce qui fait une vie – Essai sur la violence, la guerre et le deuil, Paris, Éditions Zones.
Cohen, Jim et al. (2007), « Qui a peur du postcolonial ? Dénis et controverses », Mouvements, n° 51.
Durand, Alain Philippe (dir., 2002), Black, Blanc, Beur – Rap Music and Hip-Hop Culture in the Francophone World, Lanham, Scarecrow Press.
Hebdige, Dick (2008), Sous-culture – Le sens du style, Paris, La Découverte.
Fanon, Frantz (1971), Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil.
Hall, Stuart (2008), Identités et cultures – Politiques des cultural studies, Paris, Éditions Amsterdam.
Hall, Stuart (2013), Identités et cultures II – Politiques des différences, Paris, Éditions Amsterdam.
Hamé (2010), « Insécurité sous la plume d’un barbare », < http://lmsi.net/Insecurite-sous-la-plume-d-un > (7 novembre 2013).
Hammou, Karim (2012), Une histoire du rap en France (2012), Paris, La Découverte.
Hammou, Karim (2013), « Y a-t-il une “question blanche” dans le rap français ? », in Sylvie Laurent et Thierry Leclère (dir.), De quelle couleur sont les Blancs ? Des « petits Blancs » des colonies au « racisme anti-Blancs », Paris, La Découverte, p. 190-196.
Lazarus, Neil (dir., 2006), Penser le postcolonial – Une introduction critique, Paris, Editions Amsterdam.
Lebonson (2015), « La Rumeur, entretien avec le Poison d’Avril », Le Monde, 24 novembre 2005, < http://lebonson.org/2015/04/01/la-rumeur-entretien-avec-le-poison-davril/ > (17 juin 2015).
Le Monde (2005), « Le rap à l’index », Le Monde, 24 novembre 2005, < http://www.lemonde.fr/idees/article/2005/11/24/le-rap-a-l-index_713752_3232.html > (7 novembre 2013).
Marquet, Mathieu (2013), « Politisation de la parole : du rap ludique au rap engagé », Variations, n° 18.
Monteiro, Clotilde (2008), « La Rumeur contre Sarkozy : le marathon judiciaire se poursuit », < http://www.rue89.com/2008/06/02/la-rumeur-contre-sarkozy-le-marathon-judiciaire-se-poursuit > (7 novembre 2013).
Prévos, André (1998), « Hip-Hop, Rap, and Repression in France and in the United States », Popular Music and Society, vol. 22, n° 2.
Prévos, André (2002), « Postcolonial Popular Music in France – Rap Music and Hip-Hop Culture in the 1980s and 1990s », dans Mitchell, Tony (dir.), Global Noise – Rap and Hip-Hop Outside the USA, Middletown, Wesleyan University Press, p. 39-56.
Scott, James (2009), La domination et les arts de la résistance – Fragments du discours subalterne, Paris, Editions Amsterdam.
Smouts, Marie-Claude (2010), « Les études postcoloniales en France : émergence et résistances », dans Mbembe, Achille (dir.), Ruptures postcoloniales – Les nouveaux visages de la société française, p. 309-316.
Sonnette, Marie (2014), « Des mises en scènes du “nous” contre le “eux” dans le rap français. De la critique de la domination postcoloniale à une possible critique de la domination de classe », Sociologie de l’art, vol. 2-3, p. 153-177.
Spivak, Gayatri (2009), Les subalternes peuvent-elles parler ?, Paris, Éditions Amsterdam.
Tévanian, Pierre (2009), « Les bronzés font du ch’ti – Entretien avec Dias et HK du MAP (Ministère des Affaires populaires) », Mouvements, < http://www.mouvements.info/Les-bronzes-font-du-ch-ti.html > (7 novembre 2013).
Tévanian, Pierre (2010), « Rap de fils d’immigrés », < http://lmsi.net/Rap-de-fils-d-immigres > (7 novembre 2013).
Tévanian, Pierre (2012), « ”Hors-cadre” – Entretien avec Mohamed Bourokba, dit Hamé, du groupe La Rumeur », Mouvements, < http://www.mouvements.info/Hors-cadre-entretien-avec-Hame.html > (7 novembre 2013).
Discographie sélective
Casey (2006), Tragédie d’une trajectoire, Dooen Damage.
Casey (2010), Libérez la bête, Anfalsh.
Caution, La (2005), Peines de Maures / Arc-en-ciel Pour Daltoniens, Kerozen.
Médine (2004), 11 Septembre, récit du 11ème jour, Din Records.
Ministère A.M.E.R. (1994), 95200, Hostile Records.